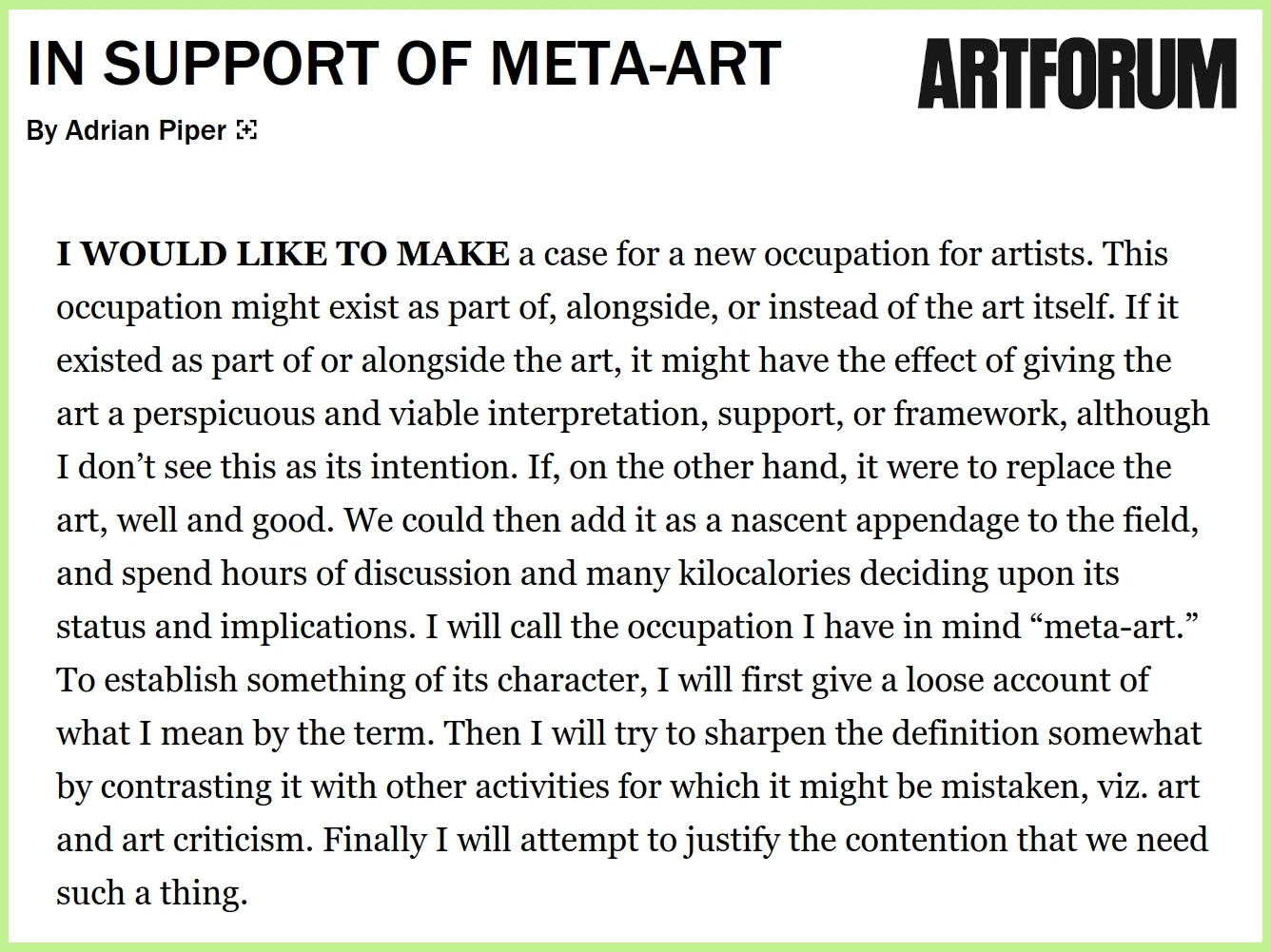Le rapport au public ou l’exception occidentale
« Matrice moderniste » est l’expression qui me vient pour désigner la forme particulière qu’a prise notre rapport à l’art en Occident. « L’art », comme nous l’entendons aujourd’hui dans les pays occidentaux, s’est développé depuis la Renaissance vers la forme nouvelle que nous lui connaissons; forme que je dis « nouvelle » par rapport à ce qu’on avait vu jusque-là et ce qu’on voit toujours dans les autres cultures. Ces autres cultures n’en sont pas moins artistiques, elles aussi : toutes les cultures font de l’art, c’est là même une des conditions de la culture. Mais parmi les diverses façons culturelles d’envisager les arts, celle qui s’est développée en Occident est unique, au point qu’il m’arrive d’y penser en termes de « l’exception occidentale ». Nos formes d’art et notre rapport à l’art sont liés à ces autres innovations que furent le système économique et les formes politiques et démocratiques qui ont émergé dans les mêmes époques et comme cette forme de société était une innovation, l’art occidental a aussi émergé dans une forme unique, nouvelle. L’art version occidentale est à la fois le produit de la modernité et l’un des grands facteurs de son développement. J’en parle comme d’une « matrice », car ce sont quelques grandes idées fondamentales qui génèrent tout le reste : ce ne sont pas seulement les œuvres, leur style, leur genre, qui déterminent le caractère occidental dans l’art, mais aussi les institutions artistiques (musées, programmes universitaires, galeries et salles de spectacle, conseils des arts), de même que nos façons de concevoir et d’être en relation avec l’art.
Le qualificatif « moderniste » peut désigner plusieurs choses différentes suivant le domaine où l’on se trouve : sociologie, théorie culturelle, histoire de l’art, pensée continentale ou anglo-saxonne… ces domaines et d’autres encore utilisent chacun cet adjectif dans un sens différent. Même si elles peuvent être éloignées en apparence, ces différentes acceptions ne sont pas contradictoires. Mon emploi du terme « moderniste », ici, les englobe tous. En effet, tout ce qu’on qualifie de moderne, que ce soit dans le style ou la philosophie, participe à mes yeux d’un même grand mouvement de la culture, d’une même grande époque : prémoderne, moderne, postmoderne, hypermoderne… tout cela appartient à la même grande famille culturelle et philosophique, le même grand mouvement de pensée lié aux réformes économiques et politiques qui ont donné naissance à nos démocraties et au capitalisme. La modernité, c’est donc tout à la fois un style et une idéologie, un type de rapports sociaux et économiques, des formes politiques… et traversant tout cela, un régime de l’art.
Il y a une courbe dans la modernité, une enfance et une sénescence. En effet, le capitalisme qui naissait il y a quatre cents ans et le capitalisme d’aujourd’hui sont différents : le premier était nouveau et inventif, le second est vieillissant et corrompu. Idem pour la science, pour la philosophie… et pour l’art : que ce soit les démocraties, les mécanismes économiques, la science ou la philosophie, il y a beaucoup de signes de fin et de décadence. Le régime de l’art associé à la matrice moderniste est lui aussi en fin de course. Il est même peut-être en avance à cet égard, comme l’art l’a souvent été sur le reste de la modernité.
Régime : Façon de régir; ensemble de règles, de facteurs qui caractérisent le fonctionnement, le cours de quelque chose. Notamment, mode d’organisation d’une société, d’un État; ensemble des institutions, des pratiques, des idées qui le caractérisent.
Les conservatoires, les musées, les concerts, les critiques d’art, l’histoire de l’art, voire l’huile sur toile, la symphonie, le théâtre d’auteur, la chanson française, les collectionneurs et les enchères, de même que l’art contemporain… tout cela appartient à la matrice moderniste. Mais sa plus grande invention est certainement le public. Par un glissement régulier sur quelques siècles, l’activité artistique s’est de plus en plus dédiée au public, trouvant en lui sa principale — et pour certains artistes, son unique — raison d’être. Dans la matrice moderniste (il y a bien sûr des exceptions et des hybrides), l’activité de l’artiste consiste essentiellement à produire l’œuvre et la fonction de l’œuvre est essentiellement d’être reçue par le spectateur. Plusieurs artistes affirment même que leur œuvre n’est pas complète tant qu’elle n’a pas été reçue par un spectateur. En matière de critique littéraire et de critique artistique, la théorie dominante est celle qu’on appelle la « théorie de la réception », qui dit en substance que l’histoire d’une œuvre est l’histoire de sa réception par les divers publics à travers les époques et les contextes sociaux, économiques et politiques; que le sens d’une œuvre se trouve dans la réception, laquelle change de récepteur en récepteur sur les époques et les cultures. Cette transaction entre l’artiste et le public via l’œuvre est à la base de la matrice moderniste. Cette manière de voir a généré les champs de la musicologie, de l’histoire de l’art et de la critique littéraire, qui scrutent les œuvres et en construisent des herméneutiques qui vont souvent même rivaliser en raffinement avec l’œuvre elle-même. On peut voir ces critiques et historiens comme des « récepteurs experts », spécialistes de l’œuvre et médiateurs de sa réception par le public.
Cette dominance de la réception et du public a aussi déterminé notre rapport à l’œuvre d’art. En Occident, nous avons tout à la fois sacralisé et réifié l’œuvre, la considérant comme un objet à part, doté d’une aura toute particulière et dont la valeur ne se calcule pas comme celle des autres types d’objets. Nous l’avons aussi détachée de son contexte : l’œuvre est publique, elle appartient à l’humanité. Son idéal est d’être « universelle », ce qui entraîne que son origine et le contexte sociopolitique dans lequel elle a été produite ne comptent plus que de façon anecdotique. Elle est autonome, autoréférentielle, self-contained; elle doit « parler pour elle-même », comme on dit. Cette autonomie n’est jamais réelle, comme en témoignent les audioguides des musées, mais peu importe : on dit encore ça dans les facultés d’art.
Je n’essaie pas de dénoncer cette matrice, mais plutôt de la rendre visible. Car tellement souvent, on la considère comme un « en soi », alors qu’en réalité, elle n’est ni universelle, ni une fatalité. Et elle a souvent été contournée au cours de l’histoire occidentale.
*
Au cours du 20e siècle, les artistes n’ont jamais cessé de tout remettre en question, de subvertir l’art jusque dans ses fondements : qu’on pense aux toiles monochromes, au silence comme musique, au mouvement dada, etc. Se croyant pour certains très contestataires de l’art, ils ne faisaient toutefois que suivre une autre des grandes caractéristiques de la modernité, l’idée de progrès, qui a traversé l’art occidental : une adhésion sans retenue au principe de progrès et de nouveauté. Il faut avancer, faire différemment d’avant, trouver ce qui n’a jamais été fait. Et pourtant, dans cette pulsion forte vers l’avant, vers le changement, jamais les bases de la matrice n’ont été ébranlées : l’artiste produit l’œuvre d’art pour le public. Au point qu’en certains lieux, on définira l’art (plus ou moins consciemment) comme quoi que ce soit qu’un artiste peut affirmer avoir produit pour un public.
On me dira que de nombreuses exceptions existent aujourd’hui, dans cette postmodernité avancée. Effectivement, j’en connais beaucoup. Mais si ces exceptions peinent à se faire reconnaître autrement que comme des exceptions, c’est justement parce qu’elles ne produisent pas pour un public. C’est la première chose qu’on leur demande : où est l’œuvre? Qui est le public visé?
Il m’arrive de penser que la notion de « public » est la grande caractéristique de la matrice moderniste, l’idée dont tout le reste a découlé. Ce serait peut-être réducteur de l’affirmer, mais s’il y a eu une séparation fondamentale (et fondatrice) dans l’art, l’invention du rapport frontal à l’art et la décontextualisation ou l’autonomisation de l’œuvre — tous deux liés au fait que l’œuvre doit être offerte au public — m’apparaissent plus déterminants encore que la séparation entre l’art et la science, l’art et la religion, ou le sujet et l’objet. En séparant la création de la réception, on a occulté le fait que l’art est une activité collective, une valeur que l’on crée parce que le monde en a besoin. Il y a en effet une continuité logique entre l’artiste dans l’intimité de son atelier, penché sur un problème formel difficile, et une foule assistant à un concert rock dans un stade : le fil, c’est le besoin de cette expérience esthétique, cette expérience de l’art, cette expérience du sens, de la beauté, de l’étonnement, du dépassement de soi, de déplacement de soi… Les humains aiment l’art, la musique, la danse et le théâtre. Ceux qui lisent, écoutent et regardent sont dans le même espace ontologique que ceux qui créent, exécutent et inventent.