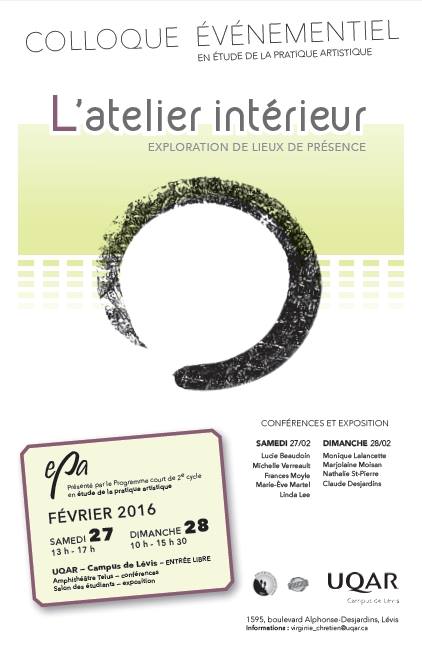Ma lettre à Ursula K. Le Guin
Ursula Le Guin va avoir 82 ans cette année, et j’ai peur qu’elle quitte ce monde avant que je me décide enfin à lui écrire. En même temps, une écrivaine est une personne occupée, n’est-ce pas, peut-être que des centaines de gens s’adressent à elle chaque mois, et j’ai lu dans son blog de l’automne dernier qu’elle avait perdu sa secrétaire. Je ne voudrais pas la déranger.
Pourquoi lui écrire? Parce que ma relation avec son œuvre est très particulière. Elle ressemble à un viaduc romain, avec ses grandes arches enjambant 35 ans de vie en quelques points symétriques. Le premier livre que j’ai lu fut Les dépossédés, probablement en 1975, au moment de sa parution en français. J’avais lu au sujet des deux grands prix de science-fiction (Hugo et Nebula) que le roman avait remportés, et aussi, j’étais très touchée par le titre. Puis quelques années plus tard, réalisant que Le Guin avait déjà remporté les deux mêmes prix pour un roman précédent, j’ai lu The Left Hand of Darkness : mon tout premier livre en anglais — j’avais acheté un dictionnaire Webster’s pour l’occasion. Tout autour de ces deux romans, j’ai lu de nombreuses nouvelles ; certaines, profondes et obscures, sont restées dans mon esprit comme des pépites radioactives : je n’ai cessé d’y revenir, de m’interroger sur le sens du sens . Lorsque j’ai lu Ceux qui partent d’Omelas — une sorte de méditation sur les compromis que nous sommes prêts à faire avec le mal — j’avais eu conscience de ne pas en saisir tout le sens, mais également conscience que je devais m’en rappeler. Cette nouvelle m’a interrogée toute ma vie.
Ensuite, il est arrivé quelque chose de très particulier lorsque j’ai réalisé que le « K. » de son nom était l’initiale de Kroeber. Je connaissais ce patronyme. Adolescente, j’avais lu Ishi, un livre bouleversant par Theodora Kroeber, épouse de l’anthropologue Alfred Kroeber, sur un Indien Yahi, dernier survivant de sa tribu décimée, recueilli par Kroeber et hébergé au musée de l’Université de Californie pendant les dernières années de sa vie. Les Kroeber étaient les parents d’Ursula Le Guin.
Plus tard, lorsque je m’intéressais aux langues anciennes (pour un projet de création) et faisais des recherches sur l’hypothétique proto-langage Amerind, l’équivalent américain de l’Indo-européen, je suis tombée sur les travaux d’Alfred Kroeber.
Connaître les parents d’Ursula Le Guin m’a donné l’impression de mieux comprendre son œuvre… car si elle écrit de la « science-fiction », il faut dire qu’en fait de science, il s’agit plus d’anthropologie que de quelque autre science — on devrait dire de l’ « anthropologie-fiction ». Elle s’inscrit donc dans la lignée familiale des anthropologues et ethnolinguistes. L’aspect créateur, voire magique, de la langue, du nom des choses, est omniprésent dans son œuvre : pour Le Guin, le monde entier répond à son nom — pour peu qu’on connaisse ce nom. Comme son père a étudié les langues amérindiennes perdues, elle a écrit sur le langage des animaux et de la nature, imaginant même une nouvelle discipline, la thérolinguistique (therolinguistics). On parlerait alors de « linguistique-fiction ».
Mon chemin a croisé son œuvre plusieurs fois. D’abord en lisant sa mère. Ensuite au tournant de la vingtaine, quand j’ai lu Les dépossédés, La main gauche de la nuit, Malafrena et un grand nombre de nouvelles. Puis je la retrouvais dans les années 1990, avec ses essais (Dancing on the Edge of the World) et un autre roman. Puis, après une autre longue absence, je me suis enfin plongée dans le cycle de Terremer, un monde inventé de sorcellerie et de dragons. Fait intéressant, elle a écrit le cycle de Terremer comme j’ai lu son œuvre : selon une séquence en « viaduc romain »… les premiers livres datant des années 1960 et le dernier dans les années 2000.
D’une décennie à l’autre, j’ai l’impression que sa fiction devient de plus en plus intérieure : moins d’aventures et plus de vie psychique, plus de réflexion, plus de ressenti. Est-ce moi, ou est-ce vraiment là l’évolution de son écriture?
Dans toute ma vie, j’ai lu davantage Ursula Le Guin que n’importe quel philosophe. Il n’y a rien d’extraordinaire à cela, dira-t-on, c’est aussi le cas de bien d’autres lecteurs de littérature. Mais pour quelqu’un d’aussi curieux de l’humain que moi, ça vaut la peine d’être noté. La fiction est un mode de recherche sur l’humain beaucoup plus performant que n’importe quel ouvrage de philosophie spéculative.
« Je savais les Contes imaginaires et non historiques, mais ils m’offraient les vérités que je cherchais et dont j’avais besoin : ils parlaient de courage, de camaraderie, de loyauté jusqu’à la mort, de lutte contre les ennemis de son peuple, de libération de son pays. » (UKL, Chroniques des rivages de l’ouest: Voix. Nantes: Librairie l’Atalante, 2010, p. 36)
Toute fiction est une sorte de « science fiction », si on voit la fiction comme une « expérience de pensée », un genre d’expérience qui appartient bel et bien à la méthodologie scientifique . Qui plus est, c’est une méga expérience de pensée, car elle ne se contente pas de penser le problème, elle met en place tous les paramètres de son contexte et de son déroulement dans le temps. En matière d’anthropologie et de psychologie, elle réussit aussi là où la science ordinaire échoue : tenir pleinement compte de la singularité des personnes et de la complexité générale que cette irréductible singularité impartit dans l’univers. Les personnages d’un roman sont des personnes à part entière, entièrement singularisées, et non des personnages génériques grossièrement esquissés. Le roman, même fantastique, doit être réaliste, les protagonistes, les événements et le contexte doivent être crédibles. Un scénario de qualité oblige une rigueur digne de l’idéal scientifique. Dans ce sens, et pour les questions de nature humaine, d’éthique, de sentiments et du sens de la vie, la fiction est bien plus scientifique que la philosophie.
À cet égard, la rigueur d’UKL est exceptionnelle. Notamment, elle évite les pièges bien connus : si elle invente des univers magiques, elle ne prend jamais le raccourci de la « pensée magique », comme tous ces scénarios qui mettent en scène la petite horde vainquant le gros système armé à l’aide de chance et de pouvoirs spéciaux (Narnia, Avatar, etc,). Non, les événements doivent être rigoureusement plausibles dans les paramètres sociaux et psychologiques qu’elle examine.
Elle aurait pu être philosophe. Elle aurait aussi pu être anthropologue. Les questions qu’elle a posées sont proches de celles d’un Erich Fromm, d’un Wilhelm Reich, d’un Confucius. Elle s’interroge sur le bien et le mal, et ce qui fait que quelqu’un est capable de l’un ou de l’autre. Elle explore les conditions de la compassion, de la vérité et de la justice. Elle s’est intéressée aux grandes innovations dans les sociétés humaines : imaginant une société où l’on peut choisir son sexe, une société sans gouvernement, différents scénarios de révolution, des interventions visant à altérer le cycle inéluctable de la vie et de la mort, des situations questionnant le bien et le mal, la sagesse et l’action. Je comprends pourquoi elle a choisi l’écriture.