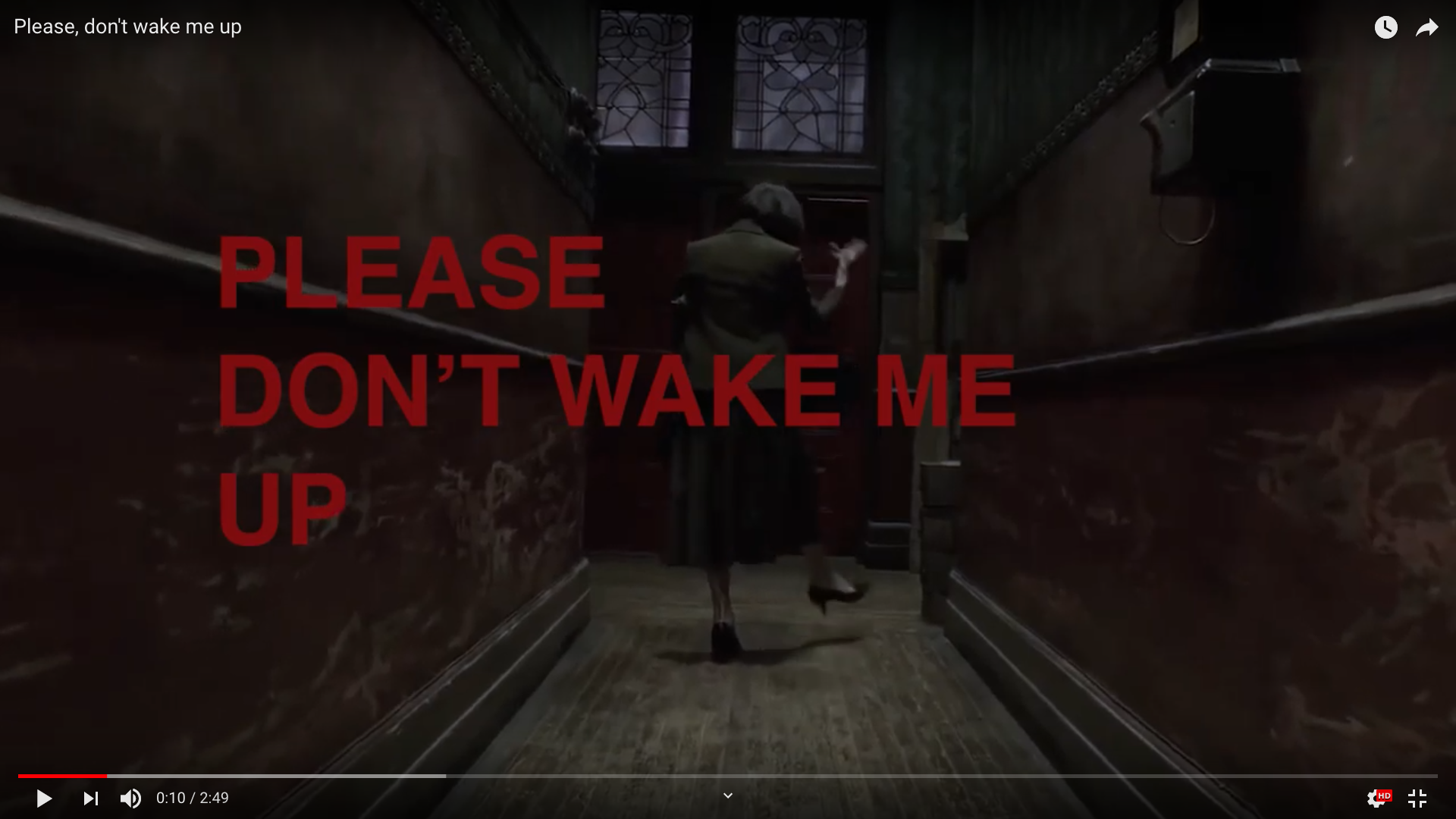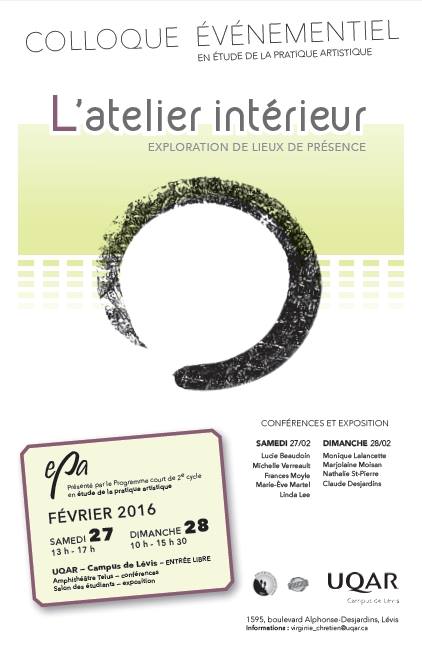IV : Une vision transhistorique de l’art
[Le poète] doit être conscient du fait évident que l’art ne s’améliore jamais, mais que le matériel de l’art n’est jamais tout à fait le même. Il doit réaliser que l’esprit de l’Europe — l’esprit de son propre pays — un esprit qu’il réalisera être plus important que son esprit privé à lui — est un esprit qui change, et que ce changement est un développement qui n’abandonne rien en route, qui ne supplante ni Shakespeare, ni Homère, ni les dessins rupestres des artistes magdaléniens.
T.S. Eliot1
Relativité et multiplicité des conceptions de l’art
Dépendamment de qui nous sommes, de la culture dans laquelle nous vivons, notre époque, notre éducation et nos affinités personnelles, nous avons une image différente de l’art. Le critique de musique classique, l’étudiant en art contemporain, l’art-thérapeute, le restaurateur d’œuvres d’art, le spécialiste de la peinture chinoise, le graffiteur, l’ethnomusicologue, l’employé d’entretien à la biennale de Venise, le philosophe allemand, l’amateur d’aquarelle, le neurologue, le maître de raku…, chacune de ces personnes — et on pourrait en imaginer bien d’autres — a une image mentale différente de l’art. (Et on notera que j’ai limité ma liste à des personnes d’aujourd’hui.)
Ce qu’on appelle « l’art contemporain » n’est qu’une petite partie de tout l’art qui se fait sur la terre. Il s’agit peut-être de la partie la plus institutionnalisée dans nos pays, celle qu’on retrouve dans les galeries urbaines, les musées, les département d’art dans les universités et les conseil des arts nationaux, mais c’est quand même une région très spécifique — et peut-être pas si typique que ça — de l’immense territoire de l’art. D’ailleurs, « le monde de l’art2 » et « l’art contemporain » sont des notions occidentales très récentes, en comparaison du fait que les arts existent dans les différentes cultures humaines depuis la nuit des temps.
L’artiste japonais Yoshio Shirakawa, dans un texte bouleversant sur la domination idéologique de l’art contemporain3, rappelle que le mot japonais désignant les beaux-arts, bijutsu, n’est apparu qu’en 1872 avec la modernisation du Japon. Si on a eu besoin de ce mot, explique Shirakawa, ce n’est pas parce que les Japonais ne faisaient pas d’art avant cette date, mais parce que les formes d’art et les manières de faire dans ces îles distantes que les occidentaux appellent « le Japon » étaient trop différentes du concept européen pour être englobées sous un seul mot.
En fait l’art est une catégorie universelle si large et diversifiée qu’on pourrait arguer que le terme ne veut rien dire à l’échelle planétaire et qu’il vaudrait mieux le limiter à la culture (aujourd’hui en voie de mondialisation) qui l’a inventé pour désigner une catégorie particulière d’activités et de produits. On voudrait alors que le terme « art » ne désigne, justement, que l’art d’inspiration occidentale associé à des institutions (universités, musées, conseil des arts, etc.) et spécialités bien définies (histoire de l’art, théorie de l’art), craignant qu’à l’autre extrême, il ne s’applique à une variété d’activités trop disparates. Quelle justification y aurait-il, en effet, à appeler « art » des activités auxquelles leurs auteurs n’ont jamais réfléchi en de tels termes, dans des cultures qui, pour plusieurs, n’ont jamais pensé à créer une catégorie de ce genre?
Je suis sensible à ces problèmes terminologiques et peut-être aurait-on besoin d’un groupe de trois mots : un mot pour le modèle, d’origine occidentale, d’art moderne et contemporain, un autre dans chaque langue pour les arts traditionnels d’une culture donnée, puis un troisième mot pour désigner la grande catégorie universelle et transhistorique englobant les arts de toutes les cultures et de toutes les époques. Car il y a bel et bien quelque chose d’universel en lien avec l’art : la danse, la musique, le chant, la peinture, la sculpture, la décoration, les contes… sont universels. Les humains préhistoriques, qui manquaient dramatiquement d’outils, qui n’avaient pratiquement aucun moyen de calcul ou système de raisonnement, qui ne connaissaient (loin s’en faut) encore ni l’écriture, ni la philosophie, ni l’agriculture, ni le commerce, ni rien de toutes ces choses essentielles à la civilisation, faisaient pourtant de l’art : ils peignaient sur les murs, sculptaient statuettes et amulettes, fabriquaient des ornements, jouaient vraisemblablement du tambour et de la flûte, chantaient, dansaient, racontaient des sagas, etc. Avant de savoir écrire, de savoir philosopher, avant de savoir cultiver un champ, les humains faisaient de l’art. N’est-ce pas remarquable, d’ailleurs? Et même à ces époques d’avant l’histoire, il semble qu’une notion d’autotélisme4 existait déjà pour la valeur de certains objets : en effet, on aurait découvert que certains des outils fabriqués par des Solutréens étaient si beaux qu’ils n’étaient pas utilisés…
De tous ces outils, les plus élaborés furent produits par l’homo sapiens sapiens il y a 40 000 ans. Ce sont des outils d’une taille très habile et délicatement épaufrés qui appartiennent à la culture des « lames en feuille » des ères de Cro-Magnon et de Solutré. Les plus beaux de tous sont les lames en forme de feuille de laurier, mais on doute qu’elles aient été utilisées, car les hommes les vénéraient pour leur beauté.
John C. Eccles5
La notion de progrès et la fin de l’histoire de l’art
Aujourd’hui, en ce début du 21e siècle, l’art à l’occidentale est dans un tournant déterminant. En ce moment, sa définition se défait et les trois catégories de l’art (moderne/contemporain, traditionnel et transhistorique) se confondent. Comme plusieurs auteurs6 l’ont fait remarquer avant moi, les cinq derniers siècles en Europe ont marqué une période faste et fascinante pour l’art — c’est la période majeure de l’histoire de l’art, c’est « l’Art » ! Mais cet « Art » très particulier quand on y pense, cet art comme catégorie autonome par rapport au reste de la société, où créateurs et spectateurs sont strictement séparés dans un face à face immobile ; cet art défini, aussi, par le besoin constant d’innovation et de rejet de l’ancien… cet art est fini. C’est la fin de l’art, a dit Danto7. Il faut bien sûr nuancer cette affirmation dramatique, mais on a bel et bien l’idée que quelque chose s’est produit, que quelque chose a changé dans l’art comme l’a connu la modernité.
Mais quoi qu’il en soit, c’est loin d’être la fin de l’art comme pratique de création. Il s’en fait encore beaucoup et selon toute vraisemblance, il s’en fera toujours. Il est possible, en fait, que la société actuelle soit en train, petit à petit, de réinventer sa relation avec l’art et la création artistique. Cette fameuse « fin de l’art » est plutôt la fin de « l’histoire de l’art », c’est-à-dire la fin d’un type d’art qui s’est historicisé, qui s’est inscrit dans la linéarité d’un avancement progressif : d’un mouvement à l’autre, on avait l’impression que l’art avançait, que chaque nouveau mouvement était la nouvelle vérité de l’art, que donc, l’art était de plus en plus ce qu’il devait être… de plus en plus abstrait, de plus en plus pur, jusqu’au moment où on est arrivé (milieu du 20e siècle environ) à la toile monochrome (noire ou blanche), à la pièce pour piano silencieuse, à la dance immobile, au texte inintelligible, à « l’objet » purement conceptuel… Si cet art est fini, c’est parce qu’il a fini par accomplir son idéal, qu’il a atteint son degré zéro. Mais ces trucs silencieux, monochromes, immobiles, n’ont pas arrêté notre élan créateur — ils ont simplement arrêté la marche de l’histoire de l’art conçue comme un progrès continu.
Ce qu’on cherchait, c’était à chaque fois des formes nouvelles, des manières nouvelles de penser l’art, de le faire, de le poser dans sa relation au réel : on expérimentait de nouvelles possibilités expressives, en même temps qu’on cherchait à s’approcher d’une vérité plus grande des médiums. Progressivement, d’ailleurs, on s’est détaché de toute considération extérieure (en terme de contenu, de fonction sociale, etc.) en cherchant à atteindre une forme pure : la peinture pure, la musique pure, etc. — d’où les monochromes et le silence. On croyait — avec raison, en un sens — que l’art « progressait » : la même notion de progrès qui galvanisait l’ensemble de la société par ailleurs. Lorsque le romantisme a remplacé le classicisme en musique, on croyait que la musique se rapprochait de l’âme. Lorsque l’atonalité a remplacé le romantisme, on croyait que la musique se rapprochait d’elle-même. En peinture, l’abstraction a remplacé les formes précédentes de représentation du réel pour toucher d’abord à une plus grande intériorité du peintre (l’expressionnisme), puis ces formes d’abstraction ont été remplacées par des considérations purement formelles : le minimalisme, la couleur pure, etc. Jusqu’à ces « degrés zéro » en peinture, en musique, en théâtre, en littérature, en danse, que j’ai déjà évoqués.
Une multiplicité post-historique
Cette marche de l’histoire de l’art, où chaque nouveau mouvement remplaçait le précédent, s’est faite rapidement. Les mouvements tombaient en désuétude avant que leurs possibilités expressives et/ou esthétiques n’aient été épuisées. Aujourd’hui, les mouvements se chevauchent, ils ne se remplacent plus. Dans les quartiers urbains où se trouvent concentrées des galeries d’art, on peut voir de tout : du portrait, du paysage, du minimalisme, de l’hyper-réalisme, de l’expressionnisme abstrait, de la peinture d’inspiration orientale, d’inspiration africaine, du néo-symbolisme, du color field et ainsi de suite, incluant de nouvelles approches, qu’on n’avait jamais vues avant. Dans la musique, on entend des accents de romantisme, d’atonalité, de jazz, de musique populaire, mêlés à des idiomes d’autres cultures8. Si je décidais de faire une œuvre polyphonique inspirée de la Renaissance, personne ne sourcillerait : on présumerait que je suis dans une recherche. Il y a coexistence des formes d’art occidentales historiques, avec des formes des cultures traditionnelles, et beaucoup d’hybrides, de syncrétisme et de fusion. À l’époque historique, on en était venu à dire qu’ « en art, tout est possible » : cela est plus vrai encore aujourd’hui car ce qui n’était pas possible alors était le retour aux mouvements passés — or cela est désormais acceptable. Et voilà qu’on reprend des recherches formelles ou spirituelles qui avaient été mises de côté dans la marche progressive de l’art ; on les étudie, on les approfondit.
Il faut encore prendre le temps de mentionner aussi que pendant sa période historique, l’art officiel ne canalisait pas toutes les énergies créatrices : il a continué à se faire beaucoup d’art non officiel, non répertorié, non historicisé. Je parle bien sûr des arts des classes populaires, a-historiques car ce sont les arts des classes dominantes qui ont fait l’histoire. Mais aussi, beaucoup de pratiques individuelles se sont développées dans l’ombre des génies reconnus — notamment par les femmes, ainsi que les artistes des groupes marginalisés, autochtones, afro-américains, immigrants. Il y a eu des moments où l’histoire de l’art a pris acte de ce qui se faisait dans ses marges et au long des siècles, plusieurs théoriciens et artistes s’y sont intéressés : qui à l’art populaire, qui à l’art brut, à l’art naïf, à l’art folklorique, l’art primitif, l’art religieux, etc. Mais maintenant que la période historique s’est terminée, tous ces arts sont sur le même pied et ont la même pertinence dans les questions que nous nous posons — en fait, ces catégories ont perdu leur importance au profit de préoccupations conceptuelles et/ou existentielles. C’est dans cet éclatement que je vois l’art prendre une dimension transhistorique : nous avons désormais une conscience élargie des possibilités historiques et anthropologiques de l’art, et c’est la rencontre avec l’art des autres et les arts passés qui nous a donné cette conscience, de façon concomitante avec l’achèvement de la quête moderne d’une vérité de l’art, de l’atteinte de son degré zéro.
L’art comme technique de soi
J’emprunte le terme « technique de soi » à Michel Foucault9 : je trouve le terme un peu morose, mais il a l’avantage d’être précis. L’expression est liée à la tradition grecque et romaine (de Pythagore et Socrate à Sénèque et Marc-Aurèle) du « souci de soi », c’est-à-dire de l’importance de se développer personnellement, de cultiver son esprit et son caractère. Dans un sens large, une technique de soi est une technique, une pratique particulière qui aide à développer le soi ou la conscience de soi. Les humains ont développé un grand nombre de ces techniques, du yoga aux arts martiaux, en passant par le journal intime, la méditation, etc… et bien entendu, toutes les techniques artistiques. J’évoquerai bientôt comment l’écriture permet la réflexivité de la conscience, et particulièrement les formes d’écriture qu’on pourrait appeler « écritures de soi » : dans ce sens, l’écriture est une des plus grandes techniques de soi.
Mais si l’écriture assiste le développement de la conscience réflexive, les arts assistent le développement de la conscience tout court10 et ce, depuis les débuts de l’humanité : Eccles en trace l’évolution parallèlement à l’évolution du cerveau humain, dans la phase dite d’hominisation. C’est une idée — ou plutôt un faisceau d’idées — très vaste que j’ai l’intention d’explorer dans d’autres textes ; je mentionne cela ici pour revenir à mon assertion du début, à l’effet qu’il se fait beaucoup plus d’art que ce qu’on retrouve dans le « monde de l’art contemporain », et ce n’est pas seulement une question de qualité des œuvres ou des pratiques. Dit simplement, la culture, le marché, l’industrie, le public — tout ce qui consomme des œuvres esthétiques — n’ont pas besoin d’autant d’art pour leurs besoins. La grande majorité des créateurs et créatrices ne travaillent pas pour ce marché ou ce monde de l’art et encore moins pour la postérité.
C’est le caractère autotélique de l’art qui fait ça : la création est une activité qu’on fait pour elle-même, pour notre enrichissement personnel, par nécessité intime. Pour certains, ce n’est qu’un loisir — honorable certes, mais sans grande conséquence — mais pour les plus sérieux et les plus engagés, dont plusieurs qui font des études avancées en art et produisent de façon soutenue, c’est une véritable technique de soi, faiseuse de conscience et d’humanité.
L’évolution de la conscience réflexive
Il me reste une dernière idée à développer dans le présent texte, celle du rapport entre l’écriture et l’art dans un contexte où la création est envisagée comme une technique de soi ou un mode de connaissance. L’idée d’écrire pour raconter notre expérience de création, un type d’écriture qui se développe actuellement dans les universités et que j’espère voir se développer plus largement11, me semble s’inscrire dans le temps présent, post-historique, mais logiquement aussi dans le prolongement de l’histoire.
En visitant une grotte paléolithique des Pyrénées, T.S. Eliot en avait conclu que l’art n’avait jamais évolué12, qu’il avait toujours été parfait — et ce, parce que le langage pictural des artistes ayant vécu 20 000 ans avant nous lui apparaissait un langage aussi achevé que celui des artistes de son époque. Le peintre français Pierre Soulages a dit quelque chose du même genre :
Il faut le dire et le répéter : il n’y a pas de progrès en art, seulement des techniques qui se perfectionnent […]. Les peintres de Lascaux ou de Chauvet ont d’emblée porté l’art à un sommet.
Pierre Soulages13
Il s’agit de déclarations d’autant plus significatives lorsqu’on les remet dans leur contexte moderniste du vingtième siècle où, justement, l’art était considéré comme étant en évolution et en continuel progrès. Mais j’ai l’impression de comprendre les propos d’Eliot et de Soulages — en fait lorsque je regarde les murales de Lascaux, je trouve moi aussi que ces fresques ne sont pas moins avancées sur le plan de l’évocation picturale que les peintures récentes. La manière dont l’artiste préhistorique s’y prenait pour représenter l’imaginaire qu’il portait dans son esprit n’est pas sous-développée. D’ailleurs, il ne s’agit pas seulement de l’art paléolithique : tous les arts, dans toutes les cultures, sont entièrement développés, c’est-à-dire entièrement aptes de manifester l’esprit de leurs auteurs. Les styles, les techniques et les matériaux varient — et le stade d’avancement technologique et scientifique d’une culture ne manque pas de se voir dans ses artefacts — mais le degré d’achèvement et d’ingéniosité n’est pas plus grand dans les cultures primaires que dans les cultures technologiques.
Ce qui évolue, car il y a bien quelque chose qui évolue, c’est la conscience réflexive. Nous sommes plus conscients de ce que nous faisons. Nous avons la philosophie, l’histoire, l’anthropologie, la théorie des systèmes, l’épistémologie ; tout cela qui nous donne une conscience historique, une conscience culturelle, planétaire, écologique, politique… Nous réfléchissons sans cesse à ce que nous faisons — et c’est cette réflexivité qui, elle, évolue sans aucun doute et s’approfondit. Et je suis d’accord avec Jung que l’un des plus importants marqueurs de cette évolution a été l’invention de l’écriture :
La découverte de l’écriture est pour moi le critère qui permet de dater l’éclosion d’une conscience responsable. Cette découverte représente un pas décisif dans l’évolution de la conscience humaine. Elle indique la naissance d’une conscience réflexive, et non simplement de la conscience.
Carl Gustav Jung14
La période historique de l’art est elle-même caractérisée par l’évolution d’une réflexion sur l’art; c’est d’ailleurs un des moteurs de cette période : chaque artiste individuellement et la communauté des arts en entier réfléchissait sur l’art. Plus encore, la prise de conscience de cette réflexion (une double réflexivité) a accompagné la fin de l’art. Il est significatif que lorsque l’histoire de l’art a trouvé sa conclusion (dans l’atteinte des degrés zéro), on a vu naître l’art conceptuel : un art qui est une pure pensée sur l’art, des œuvres qui mettent en forme une certaine philosophie de l’art. L’art conceptuel est la manifestation même de la conscience réflexive en art, qui s’est retournée sur l’histoire de l’art et a vu de quoi cette histoire était faite.
Dans ce contexte actuel, écrire sur notre pratique artistique, la sonder et en extraire les sens, la relancer et la dynamiser dans la réflexion s’inscrit dans ce moment précis de l’évolution de l’art. Réfléchir sur ce que l’on connaît par la création artistique, sonder les sens de notre expérience poïétique, cela appartient d’emblée à la période contemporaine. Une telle réflexion réinscrit notre art au cœur même de notre esprit et de notre pensée et elle augmente la connaissance de soi et du monde. L’histoire singulière de notre œuvre personnelle devient l’histoire de notre propre pensée et c’est de cet événement que nous témoignons.
Ce qui, dans l’art, n’a pas changé depuis le paléolithique ne changera vraisemblablement pas dans le 21e siècle non plus. Mais ce qui a changé, c’est-à-dire nos manières de comprendre l’art, d’en conceptualiser la fonction, le degré d’intentionnalité et ce que nous en attendons, continuera d’évoluer. En 1925 encore, T.S. Eliot écrivait sur la grande zone d’ombre « entre la conception et la création »15, mais déjà aujourd’hui, nous ne sommes plus si certains de cela.
Que des artistes veuillent interroger leur processus créateur et amener à la conscience ce qui est toujours resté dans l’obscurité, qu’ils veuillent en apprendre quelque chose et surtout, que cette réflexion puisse être une contribution à la connaissance humaine, c’est là quelque chose de nouveau. Mais dans le contexte de l’évolution de la conscience réflexive, ce n’est pas quelque chose de surprenant.
Partager la publication "IV : Une vision transhistorique de l’art"
- « [The poet] must be quite aware of the obvious fact that art never improves, but that the material of art is never quite the same. He must be aware that the mind of Europe — the mind of his own country — a mind which he learns in time to be much more important than his own private mind — is a mind which changes, and that this change is a development which abandons nothing en route, which does not superannuate either Shakespeare, or Homer, or the rock drawings of the Magdalenian draughtsmen. » T. S. Eliot, “Tradition and the Individual Talent”, cité dans C. Eshleman, Juniper Fuse: Upper Paleolithic Imagination and the Construction of the Underworld (Wesleyan University Press, 2003), p. xiii. Ma traduction. [↩]
- Pour le plaisir, il faut lire le travail ethnographique de Sarah Thornton, ne serait-ce que pour comprendre à quel point c’est un monde idiosyncratique, et à bien des égards fermé et autarcique. S. Thornton, Seven Days in the Art World (New York: W.W. Norton & Co., 2008). [↩]
- From the Eastern Land Where the Sun Rises, catalogue d’exposition, Kitakanto Museum, Maebashi, 1995. [↩]
- Notion que j’ai déjà nommée comme une des grandes caractéristiques de l’art, devant même faire partie de sa définition. Voir le texte L’art comme mode de recherche et de connaissance. [↩]
- J. C. Eccles, Évolution du cerveau et création de la conscience (Paris : Champs / Flammarion, 1994) p. 182. [↩]
- A.C. Danto, After the End of Art : Contemporary Art and the Pale of History (Princeton University Press, 1995); Y. Michaud, L’art à l’état gazeux — Essai sur le triomphe de l’esthétique (Hachette/Littératures, Éditions Stock, 2003) et La crise de l’Art contemporain — Utopie, démocratie et comédie (Paris : PUF, 1997) ; D. Kuspit, The End of Art (Cambridge University Press, 2004), et L. Shiner, The Invention of Art : A Cultural History (The University of Chicago Press, 2001). [↩]
- Arthur C. Danto, After the End of Art… [↩]
- Pour l’exemple, pensons à la musique de film, qui est un des lieux où l’on entend (sans toujours s’en apercevoir) le plus de musique originale non commerciale. [↩]
- M. Foucault, L’herméneutique du sujet (Paris : Hautes études, Seuil/Gallimard, 2001). [↩]
- Voir la deuxième partie du chapitre 4, dans D. Boutet, Paysages de l’holocène : une expérience de connaissance par la création d’art, thèse de doctorat, Université Laval, 2009. [↩]
- On a compris que le site Récits d’artistes était consacré au développement de ce type d’écriture et de réflexion sur l’expérience poïétique. [↩]
- Revoir la citation en début d’article. [↩]
- P. Soulages, Noir lumière / Entretiens avec Françoise Jaunin (Suisse : La bibliothèque des arts, collection Paroles Vives, 2002), p. 56. [↩]
- C.G. Jung, Sur l’Interprétation des rêves (Albin Michel, 1998) p. 205. [↩]
- “Between the conception / And the creation […] / Falls the Shadow”, The Hollow Men, 1925. [↩]