V : Questions de sens dans l’art :
L’œuvre vue, non plus comme objet, mais comme champ d’expérience sensible
Dans ces théories du ‘champ quantique’, la distinction classique entre les particules solides et l’espace les entourant est totalement dépassée. […] Les particules sont simplement des condensations locales de ce champ ; des concentrations d’énergie qui vont et viennent, perdant ainsi leur caractère individuel et se dissolvant dans le champ. Selon Einstein : ‘Nous pouvons donc considérer que la matière est constituée des régions de l’espace dans lesquelles le champ est extrêmement intense. Il n’y a pas de place, dans ce nouveau type de physique, pour le champ plus la matière, puisque le champ est l’unique réalité.’
Fritjof Capra1
Dans l’axe de mon intérêt pour les récits d’artistes, le présent article est construit autour de l’idée que « l’œuvre d’art » est bien plus que l’objet créé par l’artiste. J’aimerais montrer une manière de penser l’art où les fausses séparations sont réconciliées. Nous sommes si acculturés dans la pensée dualiste que nous ne réalisons pas à quel point notre pensée est structurée à partir d’une distinction de base (ontologique) entre la matière et l’esprit, entre le monde extérieur et le monde intérieur. Notre pensée sur l’art est elle aussi traversée par ces ruptures, ces conceptions dualistes. Dans la pensée orientale pourtant, il est clair que le yin et le yang sont en interaction dynamique constante et que l’un se transforme continuellement en l’autre, s’insinue continuellement au cœur de l’autre, dans une espèce de mouvement de spirale. De notre côté par contre, nous avons plutôt appris que le monde est fait d’éléments distincts, reliés entre eux par une logique causale et linéaire.
Ainsi, nous séparons processus et œuvre, auteur et récepteur, création (poïétique) et réception (esthésique), contenu et forme, révélation et expression, et ainsi de suite. Sans en être toujours conscient, nous pensons les étapes dans une suite linéaire où chacune est causée par la précédente : inspiration à conception à réalisation à œuvre à diffusion à réception à interprétation. Mais la transaction artistique n’est pas linéaire. Encouragée par la théorie des systèmes, par la notion de champ en physique (champ électromagnétique, gravitationnel, ou autre) et par les idées de chaos et de complexité, je propose donc une promenade dans un monde de l’art où l’œuvre est le processus, l’artiste un récepteur et la réception une forme de création.
L’art, mode d’expression ?
Combien d’artistes étudiants ai-je entendus exprimer un besoin de communiquer, de « conscientiser » les gens, de répandre un message politique, de faire avancer des idées… À chaque fois, je me suis dit : « Si tu as un message à transmettre, ça serait tellement plus simple d’écrire… » Et ce serait plus clair, aussi. Une telle intention est liée à une conception de l’art comme une forme de langage symbolique, c’est-à-dire comme le véhicule d’un message transmis de l’artiste au spectateur.
Je ne dis pas qu’on ne peut exprimer des idées à travers l’art. Ce n’est pas évident pour l’art abstrait ou la musique instrumentale, mais pensons aux arts politiques ou socialement engagés2, pensons aux muralistes, aux marionnettistes, au théâtre, au cinéma et à la littérature. Le désir de transmettre un message, d’exprimer des questions identitaires, de dénoncer des situations, de déconstruire des discours dominants ou des concepts aberrants, a toujours inspiré des artistes. Le désir de « dire » a été notamment un grand facteur du développement de l’intermédialité dans les années 1970 — pensons à l’installation3 par exemple. Et on ne peut douter que les contributions artistiques à diverses causes peuvent s’avérer fort efficaces4.
On peut aussi s’exprimer soi-même, s’instaurer comme message, se manifester comme preuve d’existence, se rendre visible, communiquer notre condition psychique, montrer ce qu’on voit avec l’œil intérieur. On peut aussi montrer l’autre, lui prêter nos pouvoirs expressifs, le rendre visible, lui, elle.
Mon différend avec les étudiants désireux de communiquer des valeurs et des idées via leur production artistique est plutôt lié à une certaine naïveté quant au mécanisme sémiologique de l’art, lorsqu’on voit dans l’art un mode d’expression et de communication opérant comme un discours. Par exemple, pour faire d’une œuvre d’art un discours explicite sur quelque chose, il suffirait d’insérer des signes, des icônes et des symboles dans une œuvre, des éléments qui veulent dire quelque chose, mélangés à ces autres éléments qui, eux, ne signifient rien en particulier et n’ont finalement qu’une valeur décorative. Tel trait ressemble à un oiseau en vol, telle forme orange signifie une flamme, telle forme géométrique signifie x ou y, telle couleur la mort, la passion, l’esprit, etc. L’insertion d’icônes, aussi, pourra servir de signe : le drapeau américain pour signifier les États-Unis, le signe peace and love pour signifier la paix, la croix pour le christianisme, et ainsi de suite. Plus facile encore, insérer des nombres ou des mots en alphabet ordinaire. Et que penser de ceux qui insèrent des codes cachés pour un message ésotérique !
Ce sont là des stratégies sémantiques empruntées au discours ; elles ne sont pas de nature artistique à proprement parler. Il n’est pas interdit de s’en servir, bien sûr5, et tous les exemples que je viens de donner peuvent se retrouver dans des œuvres : après tout, J.-S. Bach insérait des codes cachés dans sa musique (les lettres de son nom, notamment) et le Bread and Puppet a fait grand usage du drapeau américain. Certaines œuvres à caractère politique, même dénonciatrices, ont une grande force : elles font image, elles font réfléchir, elles nous permettent d’accéder à des niveaux de ressenti particuliers sur des questions d’importance pour l’humanité — les œuvres de Käthe Kollwitz nous en convaincront tout de suite. Mais la beauté des valeurs ou la pertinence du message ne font pas forcément la beauté ou la pertinence d’une œuvre.
L’anthologie d’art politique But Is It Art? posait directement la question : ces œuvres militantes sont-elles de l’art? Personne ne pourrait dire que non, puisque ces artistes le font en tant qu’artistes, nous posant justement la question du rôle de l’art dans la société et de la fonction subversive qu’il devrait avoir. Mais voilà, il m’intéresse de regarder pourquoi cette question se pose, c’est-à-dire sur quelles bases on pourrait douter que l’art politique, l’art porteur d’un message, soit de l’art. Il m’intéresse aussi de comprendre pourquoi l’art « discursif » (politique ou non), l’art « à message » est si facile à rater et pourquoi je pense (un peu malgré moi) que les étudiants qui croient pouvoir se servir de l’art pour passer des messages ou pour « faire le bien » sont… naïfs. Et plus naïfs encore ces commanditaires d’œuvres qui croient pouvoir se servir de l’art pour magnifier leur image ou leur message6.
D’une manière générale, le danger est que l’artiste décide à l’avance de ce qu’il veut faire dire à son œuvre — ou de ce qu’il ne veut pas qu’elle dise7. C’est précisément dans ce temps là que je trouve qu’on ferait mieux d’écrire. Dans le domaine du politique ou de l’éthique, et plus généralement dans un domaine d’action humaniste, l’art peut faire plus, et mieux, que de disséminer des slogans. On doit aussi prendre acte du fait que l’artiste et l’œuvre étant inscrits nolens volens dans la dynamique sociale, ils portent d’emblée toute une dimension de sens liée à l’ensemble des conditions de production. Toute œuvre est forcément contextuelle, quelque part, et aucun message inséré ne pourra effacer complètement cette dimension de sens : il ne pourra que la dynamiser dans un sens ou dans l’autre, en contradiction ou en synergie.
« Contre l’interprétation »
Dans l’approche traditionnelle, ce sont les récepteurs (critiques, spectateurs, historiens) qui décident de la pertinence d’une œuvre, de sa réussite ou de son échec, qui décident même de sa signification. Hans Robert Jauss (1921-1997), philosophe et théoricien de la littérature, a soutenu que l’histoire des œuvres devrait être construite à partir de l’histoire de leur réception, c’est-à-dire l’histoire des effets qu’elles ont produits sur les lecteurs au fil du temps8. Selon cette idée, le sens de l’œuvre serait au départ indéterminé — ou « ouvert », comme le dit Umberto Eco9 : c’est le récepteur qui précisera le sens de l’œuvre pour lui-même, en fonction de ses attentes, de son monde, de son contexte. Ainsi, la création qui est initiée par l’artiste se prolonge jusqu’à sa réception par le public, et l’acte de réception comporte lui aussi une dimension créatrice10. De nombreux artistes diront d’ailleurs que leur œuvre reste inachevée tant qu’elle n’a pas été reçue par quelqu’un : le spectateur, en quelque sorte, complète l’œuvre de l’artiste. Cette façon d’envisager les choses peut mener à voir l’art comme un mode d’expression et la relation entre l’artiste et le public comme une relation de communication. Mais les choses ne sont pas si simples : le rapport de sens qui relie l’artiste, l’œuvre et le récepteur est beaucoup plus complexe. Non linéaire, il ressemble plus à un « champ quantique ».
Au tout début des années 1960, Susan Sontag a écrit un essai retentissant intitulé Contre l’interprétation, dans lequel elle s’insurgeait contre la tendance à interpréter le sens des œuvres (œuvres littéraires autant que les œuvres d’art). Elle trouvait réducteur qu’on ramène une œuvre à son simple contenu et qu’on ramène ce contenu à une simple interprétation — des exégèses d’ordre psychologique ou psychanalytique, ou encore des interprétations sociologiques (analyses marxisantes, notamment). Sontag évoque « un temps où […] l’on n’avait pas l’idée de demander ce qu’exprimait une œuvre d’art, parce qu’on savait, ou croyait savoir, ce qu’elle faisait11 ». Et que fait l’œuvre ? Tout le propos de Sontag tourne autour du fait que l’œuvre affine la sensibilité, éveille (dans le sens de rendre conscient) l’intelligence des sens — et que cela est lié à l’esthétique au sens large, et non à un message à décrypter.
L’herméneutique12 appartient à la réception, le sens des œuvres émerge de l’expérience de réception. On ne peut pas remonter de notre interprétation d’une œuvre (ou de n’importe quel événement d’ailleurs) à la source de cette œuvre. Autrement dit, si je lis ou perçois un message x ou une émotion y dans une œuvre, rien ne me permet d’affirmer qu’elle était présente à l’origine dans l’œuvre ou l’événement. Mon interprétation m’appartient toujours, elle est liée à l’expérience que je fais de l’œuvre ou de l’événement. C’est un peu comme le devin qui lit dans les astres, les cartes ou les os carbonisés : le message peut être fort pertinent et « parlant », le devin peut bien avoir raison de dire qu’il lit ce message dans les os ou les cartes, mais il est erroné d’en déduire que les os ou les astres contiennent ou portent ce message.
L’art comme moyen de communication et d’expression, ou comme lieu d’incommunicable et de l’inexprimable ?
[Les réalités de l’art] élargissent les limites de la vie telle qu’elle apparaît d’ordinaire. Parce qu’elles ne reproduisent pas le visible avec plus ou moins de tempérament, mais rendent visible une vision secrète.
Paul Klee13
L’idée d’une communication à travers l’art ne signifie pas que l’œuvre soit un ensemble de signes — écrits par l’artiste, destinés à être lus par le public. Il faut poser la question de la correspondance entre les intentions de l’artiste et la réception par le public pour voir qu’en fait, il n’y a pas d’emblée de correspondance : il est pratiquement impossible d’inférer les intentions de l’artiste à partir de l’œuvre, et inversement, l’artiste ne peut prédire comment le spectateur recevra son œuvre et ce qu’il y trouvera. Pour accorder les deux, il faudra utiliser le langage : expliquer notre œuvre dans une entrevue ou des notes apposées, ou jouxter un titre évocateur. Jean-Jacques Nattiez, sémiologue de la musique, parle de cela comme d’une rupture de continuité entre la création (le niveau poïétique) et la réception (le niveau esthésique).
La stratégie constructive par laquelle le « récepteur » donne un sens [aux phrases musicales] est complètement différente de celle qui a engendré ces phrases. [Les] stratégies poïétiques — les processus créateurs — ne garantissent pas la nature et le contenu des stratégies esthésiques — les processus perceptifs, de « réception », de compréhension. Il y a discrépance, si vous me permettez cet anglicisme, entre le poïétique et l’esthésique.
Jean-Jacques Nattiez14
Nattiez insiste beaucoup sur cette discontinuité entre l’œuvre telle que l’artiste l’a conçue et l’œuvre telle que reçue par le public, au point d’y voir un fondement incontournable de toute sémiologie de la musique, et même de toute communication humaine. Dans mon expérience d’artiste, j’ai moi-même vécu cette « discrépance » avec une telle intensité qu’elle a fini par m’apparaître comme une véritable rupture — un incommunicable pratiquement ontologique logé au cœur même de l’entreprise artistique. C’est ma prise de conscience de cette distance, que j’ai même ressentie comme insurmontable, qui m’a fait décider de me concentrer davantage sur mon expérience de création et d’y trouver la justification de mes efforts. La qualité de mon expérience artistique est alors devenue l’objet central de mes préoccupations.
Tous les artistes ne réagissent pas comme moi, évidemment. Mon amie Suzanne Boisvert s’est insurgée lorsqu’elle m’a entendue raconter ce qui précède. Elle imaginait que mon affirmation impliquait de devoir cesser de communiquer avec le public : « aussi bien cesser de lui parler ou de s’adresser à lui ! », protesta-t-elle, en enchaînant que c’était peut-être mon choix, mais qu’ « il serait peut-être bien de préciser que d’autres artistes, bien qu’étant conscients de la situation, continuent tout de même de se sentir en lien avec ce ‘spectateur’ ». Si ma prise de conscience de cet incommunicable m’a amenée à me désintéresser du rapport au public pour me tourner vers l’atelier et l’enseignement, c’est parce que ma nature introvertie m’y portait, et quelque part, cette réalisation m’en donnait la permission. Mais plus largement, on peut voir la discrépance de Nattiez comme une opportunité, car si on ne peut pas utiliser l’art pour communiquer comme on utilise un système de signes, il y a beaucoup d’autres sens au mot communiquer : rencontre, collaboration, complicité, communion, co-création… Autant de termes liés à un être ensemble que l’art permet tout à fait ; plus encore, un être ensemble qu’en fait l’art dynamise.
L’art comme expérience de signifiance et mode de conscience
L’expérience artistique — autant celle de l’artiste que du spectateur, d’ailleurs — est une expérience chargée de sens.
Cela ne veut pas dire que l’œuvre d’art représente un monde clos, refermé sur lui-même. Les œuvres d’art (à l’exception, très importante, de la musique) se réfèrent au monde réel — à nos connaissances, notre expérience, nos valeurs. Elles nous offrent des témoignages, des appréciations. Mais ce qui les caractérise (ce qui les distingue de la connaissance scientifique ou discursive, de la philosophie, la sociologie, la psychologie, l’histoire, par exemple) c’est qu’au lieu de nous transmettre un savoir conceptuel, elles provoquent une sorte d’excitation, un phénomène de participation, où le jugement se trouve entraîné, captivé.
Susan Sontag15
Plus l’œuvre est réussie, plus c’est une expérience lumineuse : dans la création, on a une impression d’éclairement, de signifiance, l’impression que l’espace ou le temps de l’œuvre est tout entier signifiant, qu’on y comprend quelque chose, même si l’articulation de ce qu’on comprend est souvent impossible. Or cette expérience lumineuse, c’est la définition même de la conscience : l’expérience intime d’un monde signifiant. Plus j’y réfléchis, plus je suis convaincue que c’est là une des raisons de la centralité de l’expérience artistique dans l’expérience humaine16 : les activités artistiques génèrent une expérience sensible intensifiée, une augmentation de la conscience et du sentiment d’existence, et ce parce qu’elle convie à la fois une intention de signifiance et une attention à la signifiance. Ceci implique, il faut le noter, que chaque personne, auteur ou récepteur, fait — ou ne fait pas — sa propre expérience personnelle de sens, des sens uniques à chacun, lorsqu’elle entre en relation avec l’œuvre d’art, car l’art rend possible une expérience de signifiance, plutôt qu’une transmission de sens prédéterminés.
Dans une certaine mesure, ceci s’applique à l’expérience esthétique en général : un grand paysage, les vagues de la mer, un torrent d’eau fraîche, le skyline d’une grande ville, une église, un chant d’oiseau, ou encore les signes de l’existence d’un autre ou d’autres humains (artefacts, écrits, photos, etc.),… tout ce qui nous parait chargé de sens peut être une expérience esthétique. Dans cela, la particularité de l’art est d’être une expérience esthétique augmentée, du fait qu’elle est délibérée et intentionnelle — et cela est une distinction importante. L’expérience est augmentée par l’intention de l’artiste de créer les paramètres de cette expérience esthétique et par l’intention du spectateur de s’y exposer, d’y porter attention. S’il y a communication, et même communion, entre l’artiste et le spectateur, c’est par cette intention mutuelle. Dans l’expérience artistique, parfois même à des siècles ou des continents d’intervalles, les deux se retrouvent en présence et cette impression d’une rencontre des consciences au cœur d’une expérience de signifiance est une expérience forte qui, au moment où elle se vit, décuple le sentiment d’exister, d’être signifiant. Cette expérience est d’autant plus forte si elle est vécue avec des co-créateurs ou des collaborateurs, ou lorsque le public (qui n’est peut-être plus un « public », alors) est participant dans l’œuvre.
Création et herméneutique
Cependant le sens particulier que l’un trouve dans son expérience, c’est-à-dire son interprétation de l’expérience, n’est communicable à l’autre que par le discours, le dialogue. Entendons-nous : il va sans dire que l’œuvre est une expression de l’artiste. Elle témoigne de sa singularité, de son être, de sa présence, mais cela dans le sens large où tous les produits des êtres vivants sont des expressions : les traces d’un chat dans la neige sont une expression du chat, le nid une expression de l’oiseau, la toile une expression de l’araignée. Mais pour traduire cela en mots, en idées, pour y voir une théorie, il faut une opération herméneutique, une lecture interprétative : c’est cette lecture qui exprime les idées et c’est elle qui varie avec les contextes, les époques et les personnes17.
Cette herméneutique est un processus créateur tout à fait particulier : l’œuvre offre un espace de sens ; elle contient les paramètres d’une expérience signifiante à faire. Si le récepteur s’ouvre à cette expérience, son monde psychique est mis en mouvement, vibre avec l’énergie de l’œuvre. Si je dis qu’il crée lui-même les sens qu’il attache à l’œuvre, c’est que la signification de l’œuvre est faite du matériel psychique du récepteur. L’herméneutique, dans la réception, est le processus par lequel les potentiels de sens qui appartiennent à l’œuvre se concrétisent dans la lecture interprétative. Pour le récepteur, le sens de l’œuvre n’est ni flou ni indéterminé : il sait ce qu’il vit. Son interprétation est une réflexion de son cru à partir de l’œuvre, à chaque nouvelle rencontre (nouvelle écoute, nouveau regard) de l’œuvre.
Or cette ouverture, ou cette « indétermination » (Jauss) du sens dans les œuvres, est aussi une dynamique primordiale de la poïétique, car si l’œuvre est ouverte pour l’ensemble de la réception à venir, elle l’est aussi tout au long de sa création. Je crois que dans cette ouverture se trouve le mécanisme d’une révélation, d’un art comme mode de connaissance, comme méthode de recherche ou comme quête, et comme dynamique de travail : je crée parce que je ne sais pas ce qui va surgir. En me plaçant moi-même en position de réception continue face à l’œuvre que je suis en train de faire, je donne à cette réception une fonction autant génératrice que révélatrice — génératrice d’une toujours plus grande révélation.
L’image qui me vient est celle d’un monde saturé de mouvement et d’énergie créatrice soutenue tout au long de la dynamique artistique, des débuts de la création jusqu’aux réflexions des récepteurs — avec l’œuvre comme charnière, comme solution de continuité entre les sens liés à la poïétique et ceux émergeant dans la réception. C’est un immense champ de sens qui gravite autour de l’œuvre, faisant vibrer la sensibilité et la conscience de ceux qui s’y attardent, artiste autant que récepteur.
L’art comme mode de participation au monde
Voir l’artiste comme un simple producteur d’œuvres et l’œuvre comme un objet indépendant de son auteur et de son contexte (et échangeable sur les marchés commerciaux) met l’artiste dans une logique de « la fin qui justifie les moyens ». C’est là une logique qui fait peut-être l’affaire du marché, mais elle pose un certain nombre de problèmes à l’artiste. D’abord, elle invisibilise ou banalise l’expérience vécue pendant la production de l’œuvre et obscurcit les raisons profondes de sa création. À ne se soucier que du sort de l’œuvre, on en vient à ne pas voir une valeur en soi dans ce processus créateur et ne pas se soucier de sa qualité sur le plan humain ; ou mésestimer son potentiel au niveau du développement de la conscience. Ensuite, à nous séparer constamment des fruits de notre travail, nous nous séparons de ce qui, par ce travail, peut nous transformer, nous éclairer, nous réconforter, nous mettre au défi de la grandeur d’âme. Nous nous épuisons psychiquement.
Les contenus humains du travail s’atrophient, l’intégration au sein du salariat des anciens travailleurs autonomes (artisans, commerçants) atténue l’attachement quasi biologique porté aux activités laborieuses. Le ‘travail en miettes’ décrit par Georges Friedmann, au sein des grands ensembles industriels ou bureaucratiques s’est vidé de responsabilité et de créativité pour l’O.S., ouvrier spécialisé sur machine, ou l’employé de bureau qui remplit des formulaires. Dès lors, la personnalité niée dans le travail essaie de se retrouver hors de la zone stérile; on effectue dans le loisir des travaux où l’on se sent individuellement concerné et responsable voire inventif, comme le bricolage, ou bien on développe des talents personnels, ‘violons d’Ingres’ ou dadas, ou bien encore on fétichise dans une manie de collectionneur le besoin irrépressible de faire quelque chose par soi-même.
Edgar Morin18
Au fond, Morin suggère que le travail est un besoin; il évoque un « attachement quasi biologique » aux « activités laborieuses ». Nous ne travaillons pas seulement pour gagner notre vie, mais au départ, pour participer : participer à la communauté des humains, participer à la nature, au cosmos — « participer » dans le sens de « faire partie », « être avec », « partager ». Il faut bien se comprendre, ici : je ne parle pas de « participer » en ajoutant une œuvre esthétique à un contexte qui en aurait besoin, mais de participer en étant en relation, une relation qui s’actualise dans le temps et l’espace par les gestes (créateurs) que je pose. C’est mon « activité laborieuse » qui est cette participation. Je vis dans le monde et dans la nature en étant en relation avec lui, avec elle ; et cette relation, c’est mon activité même. Lorsque je jardine, je participe aux cycles naturels — je vis avec eux, j’en fais partie. Lorsque je crée une œuvre d’imaginaire, je participe au monde invisible de l’esprit, j’y vis, j’en fais partie. Lorsque je travaille avec des étudiants, avec des collaborateurs, d’autres humains, je participe à l’humanité, j’en fais partie. C’est par les gestes que je pose que cette relation s’établit, et ma relation a la forme de mes gestes. Si je ne travaille pas de cette manière, je ne suis pas en relation. C’est ce que Morin évoque : le travail à la chaîne, « en miettes », est une négation de ma relation créatrice avec le monde, je suis dans une « zone stérile ». Transposé à l’art, si le processus en venait à n’être plus qu’un simple « moyen » justifié par une « fin », si mon esprit ne répondait plus de mes œuvres, je risquerais de perdre le sens du lien intime et créateur qui m’unit au monde19.
Le « souci de soi » dans l’art
Dans un texte précédent20, j’ai montré que cette manière de séparer l’humain des fruits de son travail, donc d’objectifier ces fruits, était typique de la pensée capitaliste et se répercutait dans toutes les sphères d’activités, des chaînes de montage aux théories scientifiques. Tout doit être disponible pour le commerce ; et pour ce faire, tout doit être arraché à son contexte, à l’esprit, aux valeurs et aux sentiments de celui, celle ou ceux qui l’ont produit. En science, on considère comme un grand progrès le fait que les connaissances n’aient pas d’auteur et pas de contexte : « objectives », elles sont « découvertes » et non « créées ». Mais pour tous les avantages qu’on peut vouloir y voir, je crois que cette mentalité est un malheur psychique. Dans une discussion sur ce problème de séparation (entre celui qui connaît et ce qui est connu) dans la science, F. Bonardel citait Simone Weil :
C’est bien à tort qu’on a pris les alchimistes pour les précurseurs des chimistes, puisqu’ils regardaient la vertu la plus pure et la sagesse comme une condition indispensable au succès de leurs manipulations, au lieu que Lavoisier cherchait, pour unir l’oxygène et l’hydrogène en eau, une recette susceptible de réussir entre les mains d’un idiot ou d’un criminel aussi bien qu’entre les siennes.
Simone Weil21
Il s’agit là d’une immense question : que vaut une œuvre (d’art, scientifique, technologique) si son auteur n’a pas le souci de lui-même22? Toutes les sagesses du monde, de Sénèque à Jung en passant par les artistes orientaux, enseignent que les œuvres (autant humaines que divines) sont à l’image de leurs créateurs, que la vertu de l’un est indissociable de la vertu de l’autre. Mais l’idée dominante en Occident est à l’effet du contraire : on veut juger les gens à leurs œuvres et non à leur vertu. En art, en particulier, on croit que les œuvres d’un artiste transcendent la réalité psychique immédiate (névrose, addiction, etc.) de son ego ; ce qui justifie d’ailleurs une grande tolérance envers des comportements autodestructeurs ou asociaux. Dans plusieurs traditions orientales, moyen-orientales, et archaïques, c’est le contraire : c’est le développement spirituel qui est garant du développement artistique. Il vaudrait la peine d’examiner tout cela plus longuement, car on voit l’esquisse d’une distinction sous-jacente entre deux grandes approches possibles de la création23.
Sans aller pour l’instant dans une analyse de ces deux approches, on peut voir qu’en posant la question éthique uniquement à l’œuvre et non à l’artiste, l’œuvre risque la rectitude politique et la superficialité du message, comme on voit souvent d’ailleurs, et l’artiste risque le cynisme. Quoi qu’il en soit, la question de savoir s’il doit y avoir, ou non, une cohérence entre l’èthos de l’artiste — sa vie, ses comportements, ses valeurs, son identité — et ce qu’elle ou il souhaite exprimer dans ses œuvres est un faux problème. Ne pouvant séparer l’auteur de l’œuvre, je vois l’art comme une grande dynamique, intégrant travail sur la matière et travail sur soi, processus et produit, création et réception, l’auteur comme récepteur et le récepteur comme créateur, et ainsi de suite. L’image qui me revient sans cesse à l’esprit est celle d’une nébuleuse, d’une spirale, d’une sorte de vortex original où matière et esprit se co-créent et se transforment l’un en l’autre continuellement.
Pourquoi l’art ?
Pourquoi créer tant d’œuvres pour elles-mêmes, sans se soucier de l’être et de l’expérience de l’artiste? Pourquoi tant de quêtes esthétiques, si elles ne sont pas avant tout des quêtes personnelles? Avons-nous besoin de tant d’œuvres, parmi lesquelles les œuvres de réel génie sont si rares? N’y a-t-il pas déjà trop de musique, trop de peintures, trop de livres, trop de photos, trop de films? Qu’ajouterait une œuvre de plus?
Voyons les choses sous un autre angle : un groupe de personnes (auteurs et récepteurs) œuvrant à la création de sens, concentrées sur des questions esthétiques, emportées dans leur expérience sensible et réfléchissant aux questions existentielles, éthiques, spirituelles, etc., posées par une œuvre (même modeste) de création. Ça, nous n’en aurons jamais assez. Si la production artistique alimente un marché à grande valeur économique et tout un système d’institutions culturelles et académiques en tout genre, tant mieux (ou tant pis), mais ce n’est pas là la première raison de faire de l’art. La première raison d’être de l’art, autant dans l’histoire humaine que dans la majorité des histoires singulières, est autotélique : on fait d’abord de l’art pour en faire. L’art a une valeur en lui-même, une valeur intrinsèque : faire de l’art (ou s’y exposer) augmente l’Être et intensifie le sentiment d’exister, le sentiment d’humanité, cela donne de la valeur aux choses et au temps passé à les faire, cela exerce le corps et l’esprit, et ainsi de suite — c’est-à-dire des buts élevés, à grande valeur existentielle (et spirituelle, pour ceux qui se rendent jusque là).
Je ne pense pas que les quelques idées présentées ici contredisent d’autres approches de l’art. Étudier l’art, c’est comme visiter un pays : chaque personne le décrira différemment. Personnellement, c’est cette image d’une complexité foisonnante qui s’est imposée, à la place d’une dynamique sémantique simpliste. C’est aussi l’aspect hautement existentiel de l’entreprise artistique que j’espère mettre en lumière.
J’espère, d’ailleurs vaguement, produire non seulement de l’esprit, mais aussi de la beauté, de façon neuve, mais intensive. Le chemin sera long, le travail compliqué dans ses articulations subtiles.
Paul Klee24
Partager la publication "V : Questions de sens dans l’art :"
- F. Capra, Le Tao de la physique (Paris : Tchou, 1979), p. 214-215. [↩]
- N. Felshin, Nina (ed.), But Is It Art? The Spirit of Art as Activism (Seattle : Bay Press, 1995); L. F. Burnham et S. Durland, The Citizen Artist / 20 Years of Art in the Public Arena (1978/1998) (Community Arts Network, [en ligne] http://www.communityarts.net/bookstore/citizenartist.php) ; voir aussi le site Artist As Citizen, http://www.artistascitizen.org/#/home/ . [↩]
- Un des premiers grands projets d’installation fut le « Womanhouse » en 1972 en Californie. Il y a eu aussi le « Dinner Party » (1979) de Judy Chicago : des œuvres liées au féminisme et qui avaient un message fort à passer. [↩]
- Dans une manifestation altermondialiste, peu après les événements de Seattle en 1999, la police avait arrêté des… marionnettes! [↩]
- Il n’y a pas grand chose d’interdit en création artistique ! [↩]
- Le film de P. Greenaway, La Ronde de nuit (2007), sur le tableau de Rembrandt illustre bien cette naïveté des commanditaires et le fait qu’une œuvre n’est jamais seulement littérale, que des sens au deuxième ou troisième degré s’insèrent dans la transaction entre l’artiste, le public et (dans ce cas) les commanditaires. [↩]
- J’ai déjà eu une longue discussion avec une étudiante qui voulait faire une œuvre d’installation portant sur les blessures professionnelles, une problématique qui l’avait touchée personnellement alors qu’elle avait perdu sa santé dans des laboratoires de photo. Elle avait consciencieusement évité toute expression de colère, convaincue qu’il était contraire à l’éthique d’exprimer de la colère en public. [↩]
- H. R. Jauss, Pour une esthétique de la réception (Paris : Éditions Gallimard, 1978). [↩]
- U. Eco, L’œuvre ouverte (Paris : Seuil, 1965). [↩]
- C’est à cette situation que R. Barthes faisait référence en parlant de la « mort de l’auteur » et de la « naissance du lecteur » (1968). « La mort de l’Auteur », dans Le bruissement de la langue (Paris : Seuil, 1984), p. 61–67. [↩]
- S. Sontag, « Contre l’interprétation » (1961), in L’œuvre parle (Christian Bourgois éditeur, 2010), p. 13. [↩]
- « Appelons herméneutique l’ensemble des connaissances et des techniques qui permettent de faire parler les signes et de découvrir leur sens. » M. Foucault, Les Mots et les choses (Paris, Gallimard, 1966), p. 44. [↩]
- P. Klee, Théorie de l’art moderne (Paris, Éditions Denoël, 1985), p. 31. [↩]
- J.-J. Nattiez, La musique, la recherche et la vie, (Montréal : Leméac, 1999), p. 60. [↩]
- S. Sontag, « À propos du style », in L’œuvre parle…, p. 42-43. [↩]
- Pour la centralité de l’expérience artistique, voir le travail paléo-ethnologique de Ellen Dissanayake sur cette question. Homo Aestheticus: Where Art Comes From and Why (Seattle: University of Washington Press, 1995); What Is Art For? (University of Washington Press, 1988). [↩]
- D’où l’idée de Jauss, d’ailleurs, que c’est l’histoire de cette herméneutique qui est la véritable histoire de l’œuvre. [↩]
- E. Morin, L’esprit du temps : essai sur la culture de masse (Paris : Grasset, 1962), p. 86-87. [↩]
- L’histoire de l’art est jonchée des catastrophes individuelles inhérentes à cette dérive. Suicide, folie, addiction et désenchantement… Il n’est pas possible de généraliser, et je ne veux pas mettre tous les cas de déséquilibre sur le compte de ce seul facteur, mais il est intéressant de voir comment la négligence du processus n’a pas de rapport avec le génie de l’œuvre. [↩]
- Art, connaissance et transdisciplinarité. [↩]
- S. Weil, Sur la science (Paris : Gallimard, 1966), p. 275. Cité par F. Bonardel, Philosophie de l’alchimie : Grand œuvre et modernité (Paris : PUF, 1993), p. 85, n1. C’est moi qui ajoute les italiques. [↩]
- J’utilise l’expression « souci de soi » en référence à l’étude de Foucault sur ce concept gréco-romain qui l’ensemble des conditions et des exercices qui nous rendent plus aptes à appréhender la vérité et à nous transformer dans le sens du développement de notre âme : « cette formule qui sera si souvent répétée : tout homme, nuit et jour, et tout au long de sa vie, doit s’occuper de sa propre âme ». M. Foucault, L’herméneutique du sujet (Paris : Hautes Études, Seuil/Gallimard, 2001), p. 9. [↩]
- L’historien américain Morris Berman a bien décrit cette distinction dans le chapitre 10 de Coming to Our Senses: Body and Spirit in the Hidden History of the West (Seattle Writers’ Guild, 1989), chapitre intitulé « The Two Faces of Creativity ». [↩]
- P. Klee, Journal (Paris : Bernard Grasset, 1959), p. 109. [↩]


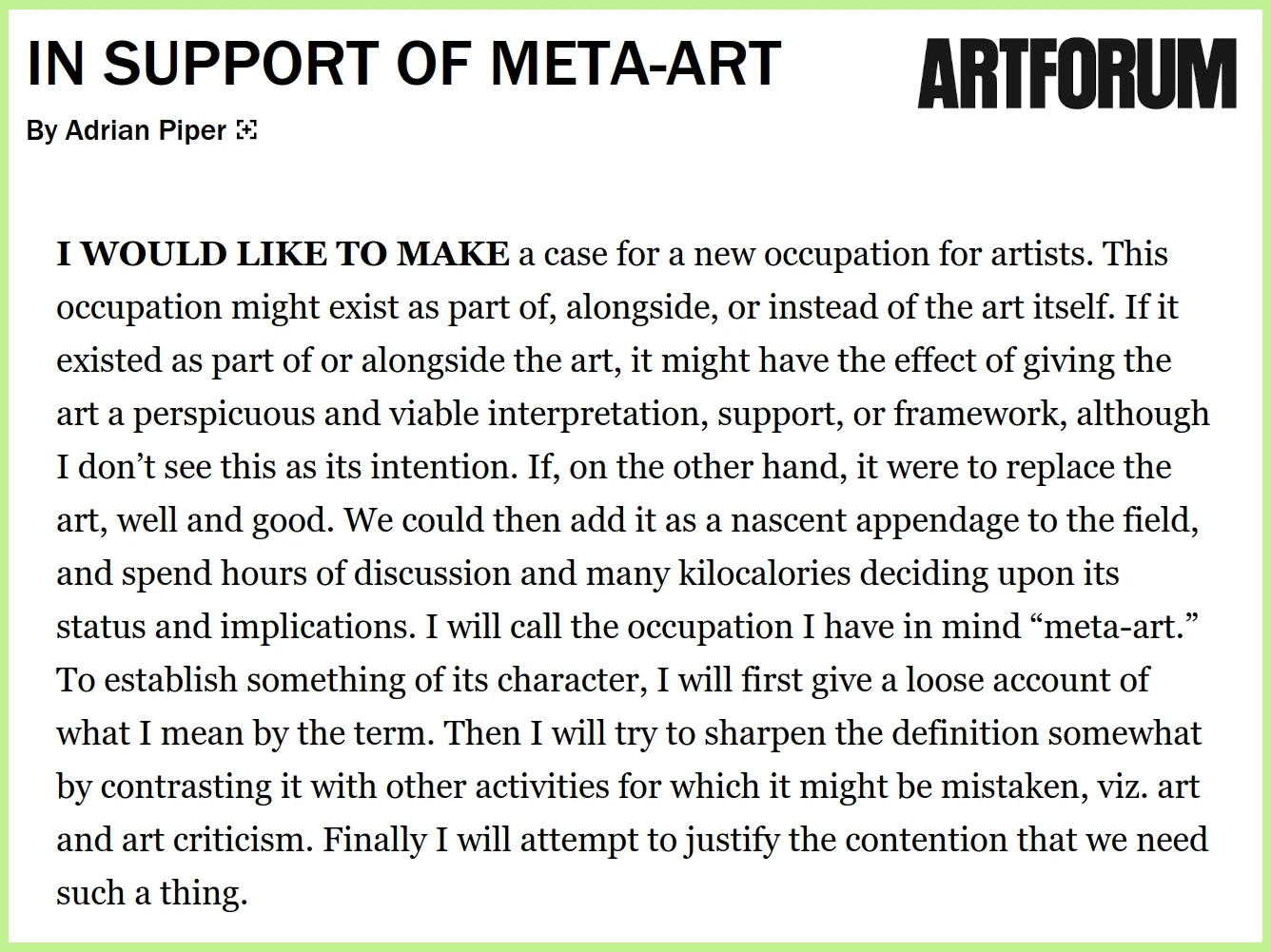





Merci pour la clarté et la portée de vos analyses.
J’ai apprécié les concepts d' »expérience de signifiance » pour bousculer ceux de l’art comme « moyen de communication et d’expression » et dans un autre de vos textes la « dimension instaurative » d’oeuvrer.
Au plaisir de vous lire.