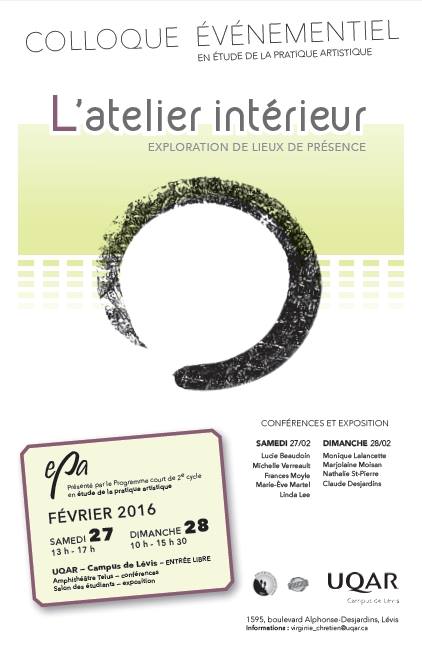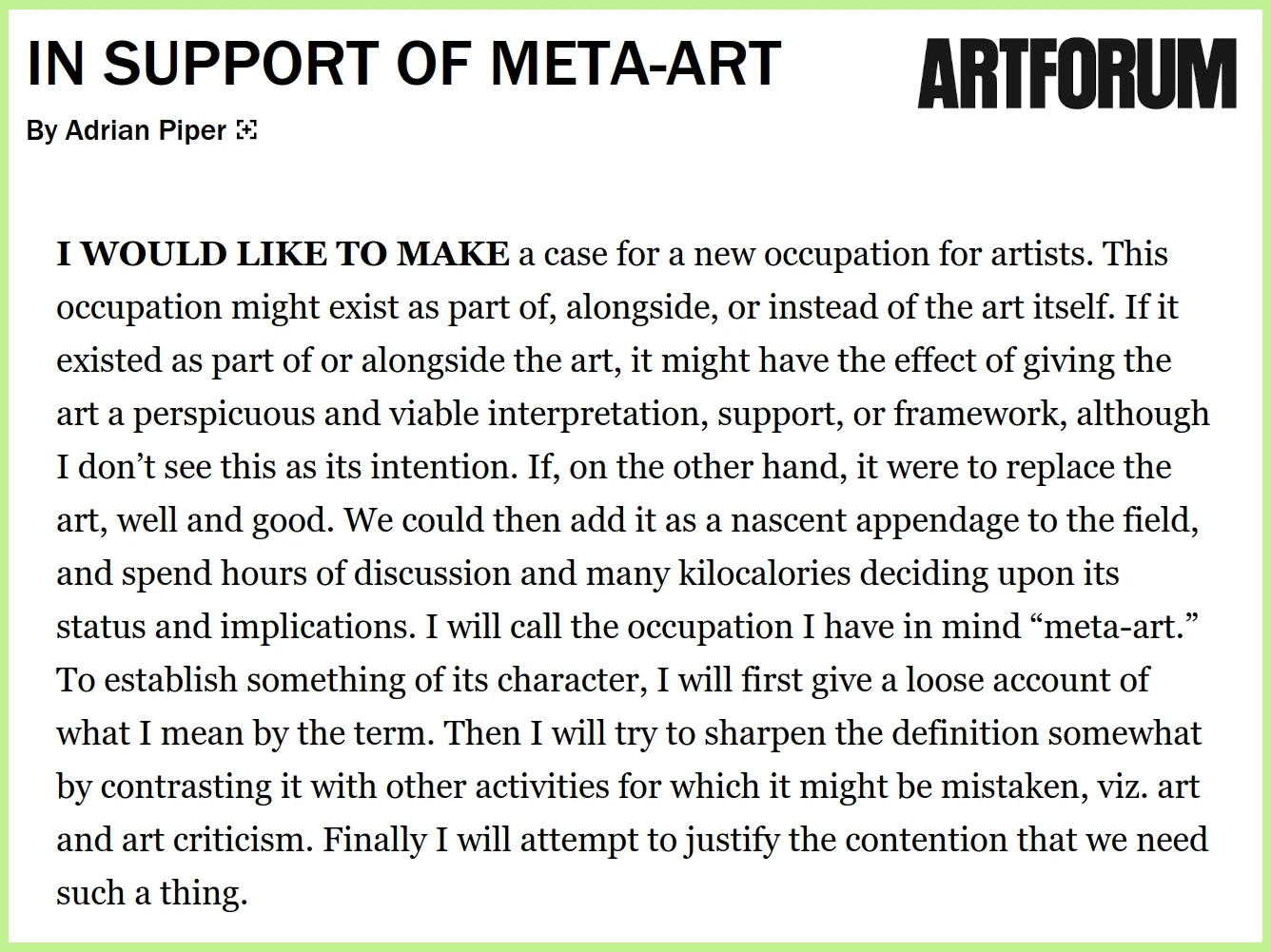III : Art , connaissance et transdisciplinarité : quelques idées
Goethe insistera sur les différences entre la connaissance de l’artiste et celle du savant. Celui-ci procède par analyse : il divise la totalité en ses éléments constitutifs ; celui-là par synthèse : il saisit la totalité dans une intuition globale. […] Mais il s’agit bien dans l’un et l’autre cas de connaissance.
Todorov 1
Einstein’s space is no closer to reality than Van Gogh’s sky. The glory of science is not in a truth more absolute than the truth of Bach or Tolstoy, but in the act of creation itself.
Koestler 2
C’est en travaillant sur le phénomène interdisciplinaire en art3 que j’ai commencé à m’intéresser à la transdisciplinarité, cet espace unifié de connaissance où toutes les disciplines se compléteraient et s’enrichiraient mutuellement dans l’espoir d’appréhender le cosmos, l’histoire et l’humain à la fois dans toute leur complexité et leur unité. Je suis alors devenue membre du Centre international de recherches et d’études transdisciplinaires, le CIRET4, qui regroupe autant des artistes et des écrivains que des physiciens, biologistes, médecins, psychologues, philosophes, théologiens, moines, ingénieurs, sociologues, économistes, etc. Cette diversité témoigne du fait que dans la perspective transdisciplinaire, on pense qu’une vision globale du monde, si elle était possible, ne serait concevable que par l’articulation dynamique des épistémologies et méthodologies conjuguées de toutes les disciplines scientifiques, des « sciences de l’humain » (anthropologie, psychologie, sociologie, histoire, etc.), de la philosophie, ainsi que des modes plus interprétatifs, introspectifs ou créateurs, comme la littérature, la psychanalyse, l’art, la théologie, le mysticisme, etc. Dans leur « projet moral », les initiateurs du CIRET précisent : « Fondé sur l’esprit de rigueur scientifique, l’activité du Centre […] permettra l’avènement d’un échange dynamique entre les sciences exactes, les sciences humaines, l’art et la tradition5. »
Les travaux de ce groupe m’ont fait poser la question de la contribution spécifique de l’art à cet ensemble transdisciplinaire. J’avais déjà le sentiment que la création artistique était un mode de connaissance, mes projets personnels de création m’ayant mise sur cette voie : même si je n’avais pas fait d’études avancées en sciences naturelles ou humaines, je savais que je connaissais quelque chose du monde, que comme artiste, je tenais un fragment de l’ensemble. J’oserais même dire que j’avais une intuition de son unité invisible.
Quand il est pleinement engagé dans une pratique de création, l’artiste éprouve souvent le sentiment d’accéder à un type particulier de connaissance ; il se sent « connaissant » et, en ce sens, il comprend qu’il participe à l’élaboration de savoirs d’un ordre particulier.
D. Laurier et P. Gosselin6
Mais quelle était la nature de ce fragment et de cette intuition? Comment définir ces « savoirs d’un ordre particulier » élaborés pendant la création d’une œuvre d’art? Que contribue l’artiste au projet transdisciplinaire?
Différents modes de connaissance
Malgré son nom, la « trans/disciplinarité » ne traverse pas seulement les disciplines, mais aussi — ce qui est bien plus important — les modes de connaissance. Il faut voir, en effet, que si la biologie, la physique et la chimie, par exemple, sont des disciplines distinctes, elles se rattachent toutes trois au même mode de connaissance, scientifique. La psychanalyse, l’histoire de l’art et la théologie, qui sont des domaines plutôt éloignés les uns des autres, utilisent tous, à un moment ou un autre, le mode herméneutique. La philosophie, elle-même subdivisée en plusieurs branches, est un mode de connaissance de type spéculatif ou rationnel. Ainsi, pour appréhender la complexité, le dialogue entre les modes de connaissance est tout autant, sinon plus, déterminant que les échanges entre les disciplines.
On n’a toujours pas l’habitude de voir l’art dans ce grand ensemble : on comprend plutôt l’art comme un mode d’expression que de connaissance, et dans l’esprit moderne, il est souvent posé comme l’antithèse de la science. On est touché par la vision du monde exprimée dans les œuvres d’art, mais on la considère comme subjective, sans valeur scientifique — la valeur du faire artistique et de l’œuvre résidant plutôt dans les émotions qu’ils nous font vivre. Mais pour penser qu’une vision artistique n’est pas une forme de connaissance, il faut avoir fait une équation entre « connaissance » et « vérité objective » — équation pourtant ni évidente ni naturelle. C’est comme si on ne pouvait connaître que des faits objectifs, et comme si une vérité, pour se qualifier comme vraie, devait valoir pour tous, être au-delà des subjectivités, sans ambiguïté. Pourtant toute certitude ne sera jamais que superficielle et ne se donnera qu’au sacrifice de la complexité.
Longtemps, connaître a signifié : avoir consciemment dans son esprit7. Mais dans le dernier siècle « la connaissance » est peu à peu devenue synonyme de connaissance scientifique et plus spécifiquement, synonyme des produits de recherche scientifique, c’est-à-dire « les savoirs » ; c’est entre autre ce qu’on entend quand on parle de « société du savoir ». Dans l’esprit contemporain, la connaissance est le produit de la recherche ou de l’étude, plutôt qu’une connaissance de type expérientiel; et le paradigme de la connaissance est désormais la connaissance de type scientifique. Pour mesurer la portée de ce glissement, il n’est pas inutile de faire un petit détour dans l’histoire intellectuelle et culturelle de l’Europe pour connecter certains points clés de l’instauration de la modernité :
- La révolution scientifique, qui à partir de la nouvelle « méthode scientifique » a produit la connaissance comme on la conçoit aujourd’hui : connaissance objective, détachable de son contexte et de l’esprit qui la pense.
- La révolution industrielle, coïncidant avec la naissance du capitalisme, qui a opéré une séparation entre le travail et le produit du travail : les ouvriers ne sont plus responsables à part entière des produits de leur travail, ils ne sont le plus souvent que des maillons dans une chaîne de production contrôlée par une entreprise qui échange ces produits librement.
- La séparation cartésienne, qui établit une distinction irréconciliable, parce qu’ontologique, entre le monde extérieur et les vécus de la conscience.
- La naissance de l’art dans sa forme moderne, basé sur les concepts d’auteur, d’œuvre autonome et de public.
- À ces quatre points, je connecterais ce cinquième, en négatif celui-là car il s’agit d’une disparition : la discréditation de l’alchimie, qui était un mode de connaissance « inséparablement méditatif et opératif, et non spéculatif8 ». L’alchimiste connaissait par l’acte d’œuvrer, mais sa connaissance, « ésotérique », était intransmissible par l’écrit.
Ces cinq points reliés esquissent une image : l’image de la séparation entre le travail et ses produits, entre « l’acte d’œuvrer » et les œuvres, entre celui qui vit, éprouve, exerce le processus de connaissance et ce qu’il connaît. Cette séparation entre les sujets œuvrant et ce qui est créé par leur activité permet la production d’objets, qui peuvent être stockés, échangés, vendus, collectionnés, téléchargés. Dans ce contexte, l’avantage de la connaissance scientifique sur les autres formes de connaissance est qu’elle produit ces savoirs objectifs, détachables et transmissibles.
Le problème, ici, n’est pas que ce type de connaissance existe. Au contraire, on ne cesse d’être impressionné par la puissance génératrice de cette épistémologie : l’essor technologique et scientifique des sociétés industrielles lui est entièrement attribuable. Ce qui pose problème est plutôt qu’elle soit devenue le paradigme, la définition même de la connaissance. De la même manière, on n’a pas à déplorer le marché des œuvres d’art, mais plutôt l’aspect prescriptif que ce système, qui sépare l’objet de son contexte de fabrication, a fini par prendre au cours des derniers siècles. Réduire un domaine d’activité humaine à ses produits est réducteur, justement : neuf fois sur dix, un livre d’histoire de l’art est, dans les faits, un livre d’ « histoire des œuvres d’art » ; et dans l’esprit de la plupart des gens, la connaissance, c’est l’ensemble des savoirs contenus dans les bibliothèques et les sites. Cela a pu contribuer à discréditer l’alchimie, qui rendait peut-être l’alchimiste plus savant mais qui ne semblait pas produire de connaissances objectives ; c’est aussi ce qui fait qu’on n’a pas tendance à voir l’art comme un mode de connaissance. Mais si, par « la connaissance », on désignait autant les processus de pensée par lesquels on arrive à connaître quelque chose que le contenu (partageable ou non) de ce qu’on sait ; si au lieu de voir la science, l’art ou les métiers comme des systèmes de production d’objets, on les voyait comme des domaines où des individus œuvrent à la poursuite de leurs questions et projets personnels, dans l’espoir de devenir plus riches de leur savoir et de leur savoir-faire ; si on envisageait aussi la connaissance comme un état de conscience, comme une expérience de l’esprit, alors les modes de connaissance non scientifiques apparaîtraient plus clairement. Apparaîtraient clairement, aussi, les modes de connaissance qui ont un effet sur la conscience, sur l’intelligence, sur l’affinement des sens, sur le sentiment d’exister, le sentiment d’être partie intégrante du monde.
« Gnosis » et « Épistémè »
Les Grecs avaient deux termes distincts pour « connaissance » : γνώσις et έπιστήμη. Le premier mot a donné gnose, gnostique, de même que le latin noscere, qui a donné connaître (conoscere). L’anglais knowledge vient sans doute aussi de gnosis, ou du moins d’une racine indo-européenne commune. L’autre a donné épistémologie, un terme plus récent (19e et 20e s.) désignant l’étude de la connaissance.
Gnosis réfère au type de connaissance que nous aurions d’une personne, d’un lieu ou d’un phénomène : avoir une relation avec, être familier, avoir une connaissance sensible. C’est un type de connaissance qui s’intensifie et s’approfondit avec l’expérience et la participation entière de notre être. Épistémè, pour sa part, désigne la connaissance acquise par l’étude, la réflexion et l’exercice9. Le verbe (epistamai) signifie « savoir » dans le sens d’ « avoir connaissance de quelque chose » et de « savoir se servir de quelque chose ». Ce type de connaissance inclut aussi les savoir-faire, dans la mesure où ceux-ci s’appuient sur des savoirs acquis, issus de l’application de l’esprit, de l’étude, de l’exercice, et inscrits dans une tradition de chercheurs et d’artisans. On comprend que le premier type de connaissance (gnostique) est intransmissible, alors que le second est tout particulièrement transmissible, justement. C’est la connaissance de type « épistémè » qui est objectifiable et vérifiable, alors que la connaissance gnostique est indissociable, intime et expérientielle et se présente d’emblée, sous forme intégrale : elle n’est pas décomposable en bits d’information.
La gnose est donc une expérience intérieure — comme une vision (qu’elle est parfois) — qui donne une « connaissance » intérieure, une certitude intérieure, autant que peut être certitude la « connaissance » qui provient de l’expérience sensible du monde10.
Il y a évidemment la présence des deux types, dans des proportions variables, dans la connaissance de tout sujet. Mais l’idéal scientifique cherche à épurer un savoir de type « épistémè » de toute forme de contamination par la subjectivité de « gnosis » ; c’est la nature de la quête scientifique moderne. Et c’est précisément dans ce choix de la science qu’émerge son opposition avec l’art, car autant la science est du type « épistémè », autant l’art est une forme de connaissance de type « gnosis » : participative, expérientielle, il s’agit de connaître dans le sens où l’on connaît quelqu’un, un lieu, un phénomène, une œuvre d’art, c’est-à-dire par la rencontre, la fréquentation, la participation, l’intimité, l’expérience sensible. Lorsqu’il peint un paysage, l’artiste peint autant sa manière de le regarder que la scène elle-même ; et si l’œuvre en résultant nous renseigne sur quelque chose, ce sera autant sur la présence de l’artiste dans le lieu, sur son expérience de la scène que sur le lieu lui-même. Si on voulait une image objective du lieu, des études scientifiques, climatologiques, géologiques, seraient beaucoup plus appropriées. Mais si on veut savoir quelque chose concernant la beauté du lieu, son atmosphère, sa sublimité, alors il faudra l’œuvre d’un artiste peintre, d’un artiste photographe, d’un cinéaste, voire d’un danseur ou d’un musicien qui, tous, seraient mieux capables d’exprimer les caractéristiques subjectives du lieu que le rapport scientifique. Mais ils exprimeraient ces caractéristiques subjectives non pas en y réfléchissant rationnellement, mais en s’immergeant dedans et en extériorisant cette expérience.
Une œuvre d’art, examinée en sa qualité d’œuvre d’art, constitue un domaine d’expérience et nullement une déclaration d’opinion ou la réponse à une question. L’art ne vient pas nous parler de quelque chose : il est lui-même ce quelque chose. L’œuvre d’art a dans le monde sa place, son existence propre, elle n’est pas simplement là comme un texte, un commentaire du monde.
Susan Sontag 11
Ainsi, plutôt qu’une connaissance objective, comme en produisent les démarches de type scientifique, ou une connaissance rationnelle comme en produit la démarche spéculative de la philosophie, la pratique de l’art mène à une connaissance expérientielle. À travers son activité créatrice, l’artiste ne connaît pas les choses de manière objective ou rationnelle, il les connait comme on connaît ce avec quoi on a une relation ; et il approfondit sa connaissance en approfondissant cette relation.
Une connaissance non séparée : médiation alchimique
Savoir, autre savoir ici, pas Savoir pour renseignements. Savoir pour devenir musicienne de la Vérité.
Henri Michaux12
Revenons maintenant à l’opposition entre mode d’ « expression » et mode de « connaissance », cette erreur catégorielle liée à notre ornière de pensée séparatrice. L’art n’est ni uniquement l’un, ni exclusivement l’autre : il serait plus juste de voir l’art comme un mode de manifestation — ce qui d’ailleurs est implicite dans le concept de création. L’art n’exprime pas quelque chose, « il est lui-même ce quelque chose », disait Sontag ci-haut. Contrairement aux idées que l’on verbalise, le sens d’un poème ou d’une musique ne pré-existe pas : il se manifeste dans l’œuvre, et c’est dans ce sens que l’art est à la fois un mode d’expression et de connaissance. En fait, c’est une manifestation dont nous faisons l’expérience. Par les images et les formes qu’il génère, les structures et les relations qu’il met en œuvre, l’artiste met en place les paramètres d’une expérience à vivre dans une dimension créée de toute pièce. Ensuite, chaque personne fera sa propre expérience de l’œuvre et pour cette raison, la comprendra différemment.
Cette expérience sensible est possible parce que l’art est matériel. Même s’il obéit d’abord à une logique poétique, métaphorique, esthétique et subjective, le travail de création confronte l’artiste aux lois physiques — surtout pour la manipulation et l’agencement des matériaux, mais aussi pour l’obtention de l’effet esthétique, l’harmonie et la dissonance, l’équilibre et le déséquilibre, etc. Les principes de la mécanique classique, de l’acoustique, de la géométrie, de la chimie, etc., ne sont pas abolis : au contraire, toutes ces lois continuent de s’appliquer et l’artiste doit en être instruit pour réaliser ses projets. Plus largement, il y a tous les contingentements de la réalité : par exemple, celui qui veut s’associer avec d’autres personnes doit tenir compte de leur caractère et de leurs limites ; il y a des contraintes de budget, de temps, d’espace… L’art ne peut exister seulement dans l’idée (et c’est en cela qu’il diffère radicalement de la philosophie), il doit se matérialiser — ou autrement « prendre forme », dans le cas des arts non matériels tels la musique ou la littérature. Or ce passage par la matière et le réel extérieur ajoute des couches importantes de sens, autant par les limites techniques ou le manque d’adresse que par les hasards heureux, les synchronicités. Ces lois de la mécanique, de la chimie, etc., et toutes ces contraintes du réel font que l’œuvre n’est jamais la matérialisation de ce que l’artiste a imaginé : son idée n’est qu’une partie de l’ensemble, qui est plutôt le résultat de la confrontation entre l’idée et la matière.
Pour l’alchimiste traditionnel, l’oratoire et le laboratoire sont toujours indissolublement liés : l’originalité de la gnose alchimique, c’est qu’elle s’appuie sur une correspondance absolue entre les étapes de l’illumination et les opérations matérielles successives.
Michel Caron et Serge Hutin13
Comme l’Œuvre alchimique, l’œuvre d’art réalise cette « correspondance absolue entre les étapes de l’illumination et les opérations matérielles ». Bonardel, dans sa définition de l’alchimie, nomme « pondération », c’est-à-dire équilibrage, cette relation dynamisante entre les potentiels et les limites respectives de la Matière et de l’Esprit ; entre les dimensions de l’imaginaire et celles du réel. Plus qu’un équilibrage, en fait, il s’agit de les mettre en mouvement l’un à travers l’autre. Les différents arts, à cet égard, opèrent des pondérations différentes : la musique, la danse, les arts visuels, la sculpture, le théâtre, la littérature, chacun implique un rapport différent entre la matière et l’esprit, entre l’espace, le temps et les idées, entre les humains et les formes, entre l’imaginaire et le réel, entre la tradition et l’innovation, entre la technologie et la mythologie, et ainsi de suite : des limites différentes, des potentiels différents, des proportions différentes de matière et d’esprit, d’humain et de technique, de concept et de hasard, de préparation et d’improvisation. Mais c’est dans l’articulation de ce rapport entre le génie humain et les formes structurantes du réel que l’art fait arriver une expérience éclairante, un ajout de sens, un vécu unique.
Et par ce caractère « opératif et méditatif », « laboratoire » et « oratoire », c’est-à-dire conjuguant le matériel et le spirituel, l’art et l’alchimie appartiennent au même mode de connaissance — comme la physique et la biologie appartiennent toutes deux au mode scientifique. En harmonisant les intuitions esthétiques / symboliques avec les résistances matérielles, l’artiste fait une médiation (ou pondération) entre le monde physique et le monde psychique. On dit de l’alchimie qu’elle « corporéifie les esprits » (coaguler) et « spiritualise les corps » (dissoudre)14, comme on dit de l’art qu’il « matérialise l’esprit » et « spiritualise la matière ».
Un sentiment d’intégration
Parce qu’il matérialise et spiritualise — opère et médite — tout à la fois, l’art pose un univers intégré15 où le psychique et le matériel ne sont plus séparés16. Ceci permet une approche par la correspondance, la réverbération, l’imaginaire et la métaphore, plutôt qu’une approche par l’analyse et la dissection, comme le fait la science. Gregory Bateson, ce grand savant transdisciplinaire avant la lettre, déplorant le résultat fragmenté et parcellaire de la recherche scientifique, a cherché une épistémologie capable d’approcher la question de l’Unité de l’homme et de l’univers, et l’a trouvée dans ces modes17, que je qualifie de « modes créateurs »18 car ils créent la vision qu’ils cherchent, ils la font arriver dans l’atelier.
L’art comme paradigme des modes créateurs
Certes ces modes créateurs ne sont pas les seuls à explorer ces questions existentielles et métaphysiques : la philosophie, la psychologie, la psychanalyse, c’est-à-dire des modes de type spéculatif et herméneutique, s’y intéressent. Mais l’art s’en distingue de cette façon : il n’interprète pas des vécus intérieurs, il crée des conditions pour que de tels vécus se produisent. L’art ne raconte pas, il fait vivre.
L’art se distingue aussi de l’alchimie en ce qu’il ne cherche pas à connaître une hypothétique vérité de Soi et du Monde, il cherche plutôt à générer des possibles, à agrandir le champ du ressenti, à explorer de nouvelles manières d’être, à rendre visible, audible et perceptible quelque chose qui n’existe pas. L’expérience que nous faisons lorsque nous écoutons une musique ou assistons à un spectacle, lorsque nous dansons, chantons ou dessinons, ce que nous ressentons en lisant un poème ou regardant un film… ces expériences sont impossibles autrement, et c’est la raison d’être de l’art. Alors que tous les autres modes de connaissance sont tournés vers la recherche de vérités (qu’elles soient scientifiques, psychiques, métaphysiques ou spirituelles), l’art et la poésie cherchent de l’autre côté, tournés vers ce qui n’est pas visible encore, ce qui n’est pas manifeste encore — ce qui n’existerait pas autrement. « Fabriquer des mondes cohérents qui répondent à des vérités immatérielles », dit Anne Dillard19. Je ne peux m’empêcher de partager, ici, cette citation du médecin alchimiste Paracelse :
L’homme a un atelier visible qui est son corps et un invisible qui est son imagination. […] De même que le monde n’est qu’un produit de l’imagination de l’âme universelle, l’imagination de l’homme (qui est un petit univers) peut créer ses formes invisibles et celles-ci se matérialiser.
De virtute imaginativa20
Échanges entre les modes de connaissance dans l’espace transdisciplinaire
Je terminerai par quelques considérations sur l’échange transdisciplinaire entre les modes de connaissance. Pour pouvoir dialoguer, les différents modes doivent pouvoir se faire connaître et s’expliciter les uns aux autres : se rendre visibles et intelligibles par delà les vocabulaires, les corpus théoriques et les spécificités conceptuelles de leurs champs respectifs. Il y a nécessité d’un méta-discours, un niveau supérieur où les différences et les complémentarités sont rendues explicites. Je ne pense pas, notamment, que les artistes puissent se contenter de proposer des œuvres d’art à la contemplation de penseurs — sociologues, physiciens, philosophes, théologiens, etc. — qu’on place alors en position de récepteurs et d’herméneutes. Il faut pouvoir articuler la noèse et la gnose spécifiques à la pratique artistique — de façon à situer l’art au sein de l’ensemble transdisciplinaire. Et si l’on veut articuler cela avec un degré minimal de spécificité et de précision, on ne peut le faire qu’à travers des ouvrages écrits ou des communications, susceptibles de participer à une conversation qui se fait déjà sur ce mode discursif ; le défi étant de rendre intelligible comment l’artiste connait le monde en tant qu’artiste.
On comprendra toutefois que les artistes eux-mêmes sont les mieux placés pour présenter ce point de vue. Les philosophes, critiques et historiens d’art ou du cinéma, critiques littéraires, musicologues, etc., parleront davantage en termes d’expérience esthésique, donc d’un point de vue herméneutique. Mais l’expérience poïétique — l’expérience de création — est autre chose, qui ne peut être rapporté que du point de vue d’un créateur21. Écrire sur l’art d’un point de vue poïétique ou écrire sur l’art du point de vue de la réception, c’est écrire sur des sujets différents, car la création et la réception sont deux expériences différentes d’un point de vue épistémologique : deux expériences de connaissance liées l’une à l’autre de bien des façons, mais différentes néanmoins. Sur le plan de la transdisciplinarité cette différence est importante et implique que le point de vue des artistes sur leur propre poïétique en tant que mode de connaissance est irremplaçable.
Partager la publication "III : Art , connaissance et transdisciplinarité : quelques idées"
- T. Todorov, « Goethe sur l’art : Aimer Goethe? ». Dans Goethe, Écrits sur l’art (Paris: Flammarion, 1996), p. 31. [↩]
- Arthur Koestler, The Act of Creation (London: Pan Books, 1970), p. 253. [↩]
- C’est-à-dire les processus de création impliquant des médiums divers, des changements de médiums ou des nouveaux médiums, liés ou non à des disciplines artistiques reconnues. [↩]
- http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/ [↩]
- CIRET, Le projet moral, art. 6. http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/projfr.htm [↩]
- D. Laurier et P. Gosselin (dir.), Tactiques insolites : vers une méthodologie de recherche en pratique artistique (Guérin Éditeur, 2004), 168–169. [↩]
- « Depuis le XIIe s. (1160) connaître signifie particulièrement « avoir dans l’esprit en tant qu’objet de pensée analysé… » Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, t. 1, p. 853. [↩]
- F. Bonardel, Philosophie de l’alchimie (Paris : PUF, 1993), p. 23 (italiques dans le texte). [↩]
- A. Bailly, Abrégé du dictionnaire grec-français [en ligne]. http://home.scarlet.be/tabularium/bailly/index.html (consulté le 5 novembre 2008). [↩]
- S. Melanson, Jung et la mystique (Éditions Sully, 2009), p. 61. [↩]
- S. Sontag, « À propos du style », in L’œuvre parle (Christian Bourgois éditeur, 2010), p. 42. [↩]
- Vers d’Henri Michaux dans F. Bonardel, Philosophie de l’alchimie (Paris : PUF, 1993), p. 25. Sur Michaux, voir aussi J. Roger, Henri Michaux : Poésie pour savoir (Lyon, PUL, 2000). [↩]
- M. Caron et S. Hutin, Les alchimistes (Paris : Seuil, 1959), p. 155. N. Bourriaud évoque aussi cette conjonction de l’oratoire et du laboratoire dans l’art : Formes de vie : l’art moderne et l’invention de soi (Paris : Éditions Denoël, 1999), p. 40. [↩]
- F. Bonardel, La Voie hermétique (Paris: Dervy, 2002), p. 101. [↩]
- C’est la proposition de G. Bateson dans son article sur l’art balinais : « Style, grâce et information dans l’art primitif », Vers une écologie de l’esprit — 1 (Paris : Seuil, 1977), p. 167–194. [↩]
- Il est peut-être utile de noter, ici, que cette façon de penser l’Unité de l’Homme et de l’univers, de l’esprit et de la matière, est un grand archétype : « Dans la philosophie hermétique de toutes les époques », écrit Hutin, « on constate une perpétuelle, une constante volonté de mettre en parallèle la structure même de l’homme et celle du Monde, des lois cosmiques ». (Histoire de l’alchimie, Marabout Université, 1971, p. 72.) Rappelons la célèbre première phrase de la Table d’émeraude : « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Hutin cite ensuite l’historien Delumeau : « Le monde est conçu comme un tissu de correspondances secrètes, de sympathies et d’aversions occultes, comme un dialogue d’étoile à étoile et entre les étoiles et l’Homme ». Ce qui rappelle Baudelaire : « La Nature est un temple où de vivants piliers / Laissent parfois sortir de confuses paroles ; / L’homme y passe à travers des forêts de symboles / Qui l’observent avec des regards familiers. » (« Correspondances », dans Les fleurs du mal). [↩]
- G. Bateson, Une unité sacrée : Quelques pas de plus vers une écologie de l’esprit (Paris : Seuil, 1996) ; et G. et M. C. Bateson, La Peur des anges (Paris : Seuil, 1989). [↩]
- En support à cette proposition, mentionnons que le physicien W. Heisenberg, dans Le Manuscrit de 1942 (Paris : Allia, 2004), adopte la formulation « facultés créatrices » pour parler de ces modes, formulation qu’il empruntait à Goethe. [↩]
- En vivant, en écrivant (Christian Bourgois éditeur, 1996), p. 23. [↩]
- Cité par S. Hutin, Hist. de l’alchimie, p. 189. Cité aussi par W. Pagel, Paracelsus: an Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance (2nd ed.) (NY: Karger, 1982), p. 121. [↩]
- Ce qui n’exclut en rien la possibilité que des tiers — historiens, théoriciens ou critiques par exemple — travaillent en collaboration avec des créateurs, ou à partir de leurs documents, sur l’explicitation de leur poïétique. Voir notamment l’exemple de la revue Circuits — Musiques contemporaines : La fabrique des œuvres volume 18, numéro 1 (2008). [↩]