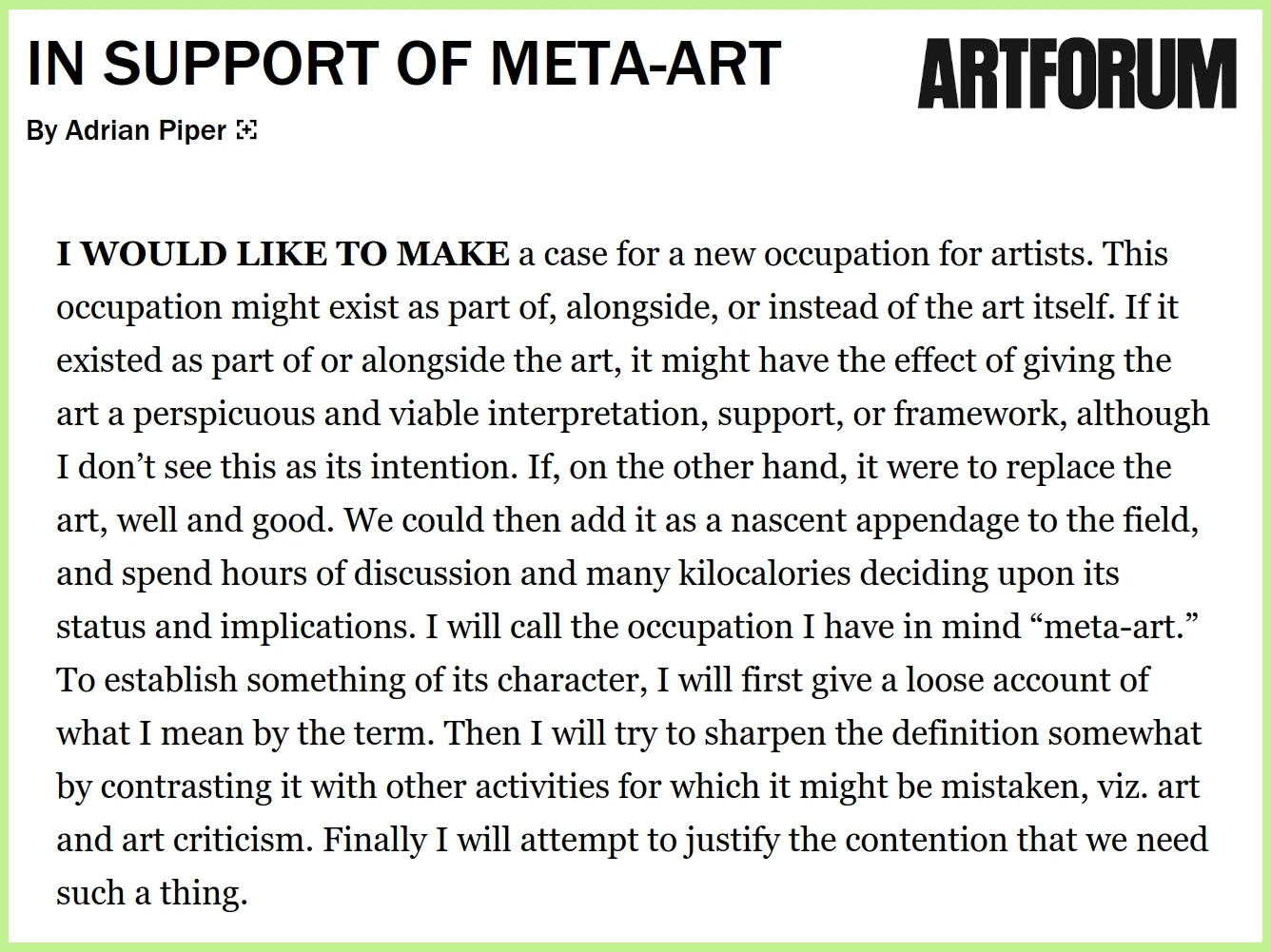L’idée de méta-art : Adrian Piper, 1973
Adrian Piper, “In Support of Meta-Art”, Out of Order Out of Sight, MIT Press, 1996, 17-27. Résumé et discussion: Danielle Boutet, professeure agrégée, Université du Québec à Rimouski Introduction : cohérence des projets C’est en 1973 qu’Adrian Piper publie In Support of Meta-Art[1] dans la revue Artforum[2]. On est alors en pleine époque de l’art conceptuel…